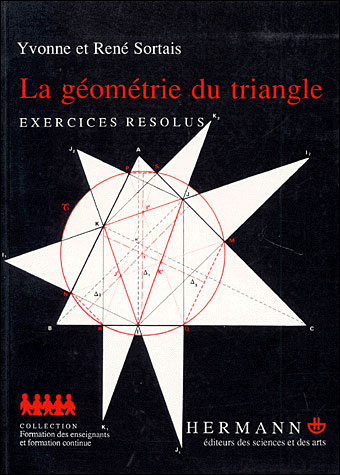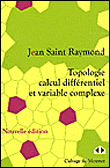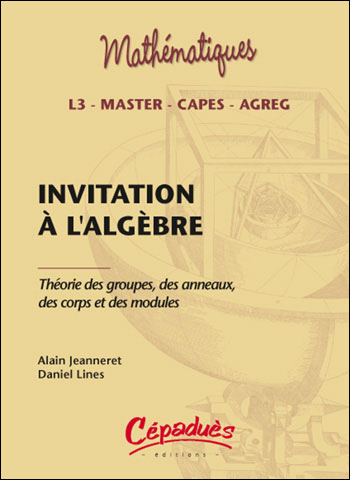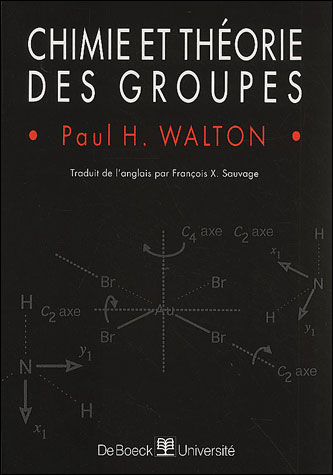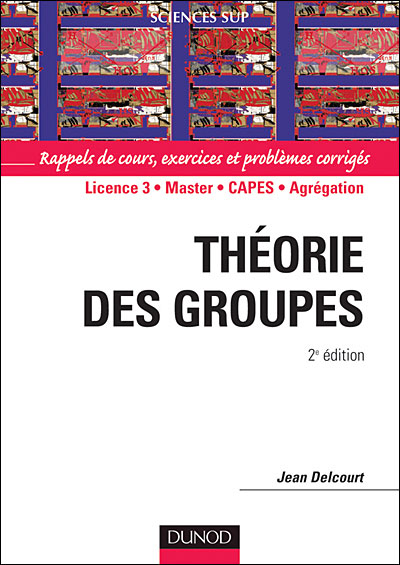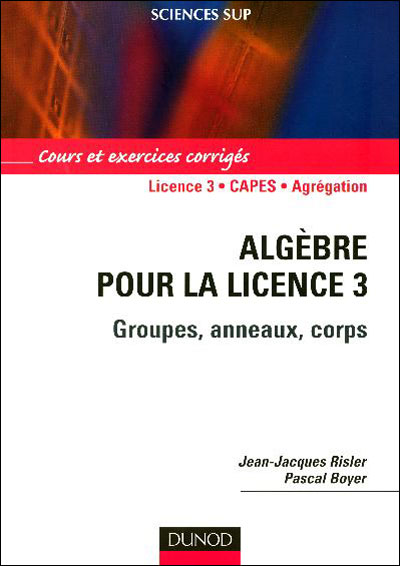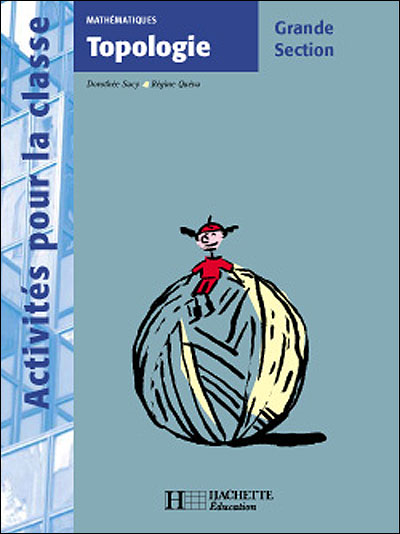28/01/2011
Statistique en action , Cours et problèmes corrigés : master et agrégation de mathématiques Gilles Stoltz, Vincent Rivoirard Livre
22:57 | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
L'horloge de l'éternité Brian Hayes Essai (broché). Paru en 10/2010 Livre
22:56 | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Contrôle optimal , Théorie et applications - Deuxième édition revue et corrigée Emmanuel Trélat Etude (broché). Paru en 11/2008 Livre
22:53 | Lien permanent | Commentaires (1) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Lemme de Gauss (théorie des nombres)
Lemme de Gauss (théorie des nombres)
Source : http://dictionnaire.sensagent.com/lemme+de+gauss+(th%C3%A... Un article de Wikipedia, l'encyclopédie libre.Pour les articles homonymes, voir Théorème de Gauss.
Un lemme de Gauss est utilisé en théorie des nombres dans certaines démonstrations de la loi de réciprocité quadratique [1]. Pour n'importe quel nombre impair p, soit a un entier qui est relativement premier à p. On considère les entiers et leurs plus faibles résidus modulo m. Soit n le nombre de ces résidus qui sont plus grands que p/2. Alors où Ceci peut, par exemple, être appliqué immédiatement quand a = −1, donnant D'un point de vue plus sophistiqué, ceci est un cas de transfert. PreuveUne preuve assez simple de ce lemme peut être déduite du principe utilisé pour la démonstration dupetit théorème de Fermat. Pour cela, évaluons le produit suivant : modulo p de deux manières différentes. Premièrement, ce produit vaut : Le second calcul est plus délicat. Si x est un résidu non nul modulo p, définissions la "valeur absolue" de x comme Comme n dénombre les multiples ka se trouvant dans le second intervalle, et que pour ces multiples,−ka se trouve dans le premier intervalle, on a : Maintenant, observons que les valeurs |ra| sont distinctes pour r = 1, 2, ..., (p−1)/2. En effet, si |ra| = |sa|, alors ra = ±sa, et donc r = ±s (parce que a est inversible modulo p), donc r = s car ils appartiennent tous deux à l'intervalle 1 ≤ r ≤ (p−1)/2. Mais il y en a exactement (p−1)/2, donc cette séquence représente une permutation des entiers 1, 2, ..., (p−1)/2. On obtient : En comparant avec notre premier calcul, on peut supprimer les facteurs non nuls : ce qui nous donne Ceci est le résultat souhaité, car la partie de gauche n'est qu'une réécriture du symbole de Legendre(a/p). Références
Liens externes
. |
This entry is from Wikipedia, the leading user-contributed encyclopedia. It may not have been reviewed by professional editors (see full disclaimer) . Donate to wikipedia. Licence : Wikipedia. This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
22:26 | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Solutions aux exercices: Théorie des nombres
Solutions aux exercices: Théorie des nombres
SOURCE : http://www.mathgoodies.com/francais/volume3/solutions_vol...
![[IMAGE]](http://www.mathgoodies.com/francais/volume3/images/red_arrow.gif) Facteurs et plus grands communs facteurs
Facteurs et plus grands communs facteurs
![[IMAGE]](http://www.mathgoodies.com/francais/volume3/images/red_arrow.gif) Multiples et plus petits communs multiples
Multiples et plus petits communs multiples
![[IMAGE]](http://www.mathgoodies.com/francais/volume3/images/red_arrow.gif) Nombres premiers et composés
Nombres premiers et composés
![[IMAGE]](http://www.mathgoodies.com/francais/volume3/images/red_arrow.gif) Tests de divisibilité
Tests de divisibilité
![[IMAGE]](http://www.mathgoodies.com/francais/volume3/images/red_arrow.gif) Exposants
Exposants
![[IMAGE]](http://www.mathgoodies.com/francais/volume3/images/red_arrow.gif) Suites logiques et exposants
Suites logiques et exposants
![[IMAGE]](http://www.mathgoodies.com/francais/volume3/images/red_arrow.gif) Exercices de défi
Exercices de défi
| Exercice | Problème | Solution |
| 1 | Trouve le plus grand commun facteur de 18 et 36. | Facteurs de 18 : 1, 2, 3, 6, 9, 18 Facteurs de 36 : 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36 PGCF = 18 |
| 2 | Trouve le plus grand commun facteur de 30 et 48. | Facteurs de 30 : 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30 Facteurs de 48 : 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 48 PGCF = 6 |
| 3 | Trouve le plus grand commun facteur de 42 et 56. | Facteurs de 42 : 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21, 42 Facteurs de 56 : 1, 2, 4, 7, 8, 14, 28, 56 PGCF = 14 |
| 4 | Trouve le plus grand commun facteur de 16, 48 et 72. | Facteurs de 16 : 1, 2, 4, 8, 16 Facteurs de 48 : 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 48 Facteurs de 72 : 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 36, 72 PGCF = 8 |
| 5 | Un jardin rectangulaire a une aire de 18 mètres carrés. Une autre cour rectangulaire a une aire de 81 mètres carrés. Quelle est la plus grande dimension commune que peuvent avoir ces deux jardins? |
Facteurs de 18 : 1, 2, 3, 6, 9, 18 Facteurs de 81 : 1, 3, 9, 27, 81 PGCF = 9 |
| Exercice | Problème | Solution |
| 1 | Trouve le plus petit commun multiple de 9 et 10. | Multiples de 9 : 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90, 99, ... Multiples de 10 : 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, ... PPCM = 90 |
| 2 | Trouve le plus petit commun multiple de 14 et 42. | Multiples de 14 : 14, 28, 42, 56, 70, 84, ... Multiples de 42 : 42, 84, ... PPCM = 42 |
| 3 | Trouve le plus petit commun multiple de 18 et 30. | Multiples de 18 : 18, 36, 54, 72, 90, 108, 126, 144, 162, 180, ... Multiples de 30 : 30, 60, 90, 120, 150, 180, ... PPCM = 90 |
| 4 | Trouve le plus petit commun multiple de 8, 9 et 12. | Multiples de 8 : 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80, ... Multiples de 9 : 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90, ... Multiples de 12 : 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, ... PPCM = 72 |
| 5 | Mme Hernandez arrose une de ses plantes à tous les 10 jours et une autre à tous les 14 jours. Si elle arrose les deux plantes aujourd'hui, quand sera la prochaine fois où les deux plantes seront arrosées la même journée? | Multiples de 10 : 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, ... Multiples de 14 : 14, 28, 42, 56, 70, 84, 98, ... PPCM = 70 (Réponse : dans 70 jours) |
| Exercice | Problème | Solution |
| 1 | Chacun des nombres suivants est composé SAUF : 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 21 et 24 25 et 27 23 et 29 Tous sont composés. |
23 et 29 |
| 2 | Chacun des nombres suivants est premier SAUF : 31, 37, 39 39 37 31 Tous sont premiers. |
39 |
| 3 | Les nombres premiers entre 40 et 49 sont : 42, 43 et 47 41, 43 et 47 43, 45 et 47 Aucune de ces réponses. |
41, 43 et 47 |
| 4 | Les nombres premiers entre 50 et 59 sont : 53 et 59 51 et 59 53 et 57 Aucune de ces réponses. |
53 et 59 |
| 5 | Les nombres premiers entre 20 et 59 sont : 21, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47 et 53 23, 29, 31, 33, 37, 41, 43, 47 et 59 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53 et 59 Aucune de ces réponses. |
23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53 et 59 |
| Exercice | Problème | Solution |
| 1 | Le nombre 477 est divisible chacun des nombres suivants SAUF : 3, 6, 9 3 9 6 Aucune de ces réponses. |
6 |
| 2 | Le nombre 348 est divisible par chacun des nombres suivants SAUF : 2, 3, 4, 5, 6 6 5 4 Aucune de ces réponses. |
5 |
| 3 | Si un nombre est divisible par 9, alors il est également divisible par quel nombre? 3 6 2 Aucune de ces réponses. |
3 |
| 4 | Lequel de ces nombres est divisible par 4? 150 269 480 Aucune de ces réponses. |
480 |
| 5 | Lequel de ces nombres est divisible par 6? 213 468 621 Aucune de ces réponses. |
468 |
| Exercice | Problème | Solution |
| 1 | Écris le nombre 45 sous la forme standard. | 45 = 4 x 4 x 4 x 4 x 4 = 1 024 |
| 2 | Écris le nombre 54 sous la forme standard. | 54 = 5 x 5 x 5 x 5 = 625 |
| 3 | Quel est le nombre 500 000 000 à la puissance zéro? | 1; Tout nombre quel qu'il soit (sauf 0) élevé à la puissance zéro est toujours égal à 1. |
| 4 | À quel nombre équivaut le nombre 237 élevé à la puissance un? | 237; Tout nombre élevé à la puissance 1 est toujours égal à lui-même. |
| 5 | Le nombre 81 est le nombre 3 élevé à quelle puissance? | 81 = 3 x 3 x 3 x 3, ou 3 à la puissance 4. |
| Exercice | Problème | Solution |
| 1 | Les nombres 1, 5, 25, 125, 625, 3 125, ... sont tous des puissances de quel nombre? | 5 |
| 2 | Dans l'exercice un, quel est le prochain nombre de la suite? (N'insère ni espaces ni virgules dans ta réponse) | 15625 |
| 3 | Les nombres 1, 6, 36, 216, 1 296, ... sont tous des puissances de quel nombre? | 6 |
| 4 | Le nombre 10 000 000 000 000 est le nombre 10 à quelle puissance? | 13 |
| 5 | Si 14 est égal à 1, alors combient vaut 1100? | 1 |
| Exercice | Problème | Solution |
| 1 | Une piscine rectangulaire a une aire de 24 mètres carrés. Une autre piscine rectangulaire a une aire de 90 mètres carrés. Quelle est la plus grande dimension commune possible aux deux piscines? | Facteurs de 24 : 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24 Facteurs de 90 : 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 15, 18, 30, 45, 90 PGCF = 6 (Réponse : 6 mètres) |
| 2 | Un corridor d'école possède une longue rangée de casiers. Chaque sixième casier contient un paquet de gomme à mâcher, chaque huitième casier contient un bâton de hockey et chaque neuvième casier contient un miroir. Si le premier casier contient les trois items, quel est le prochain casier qui les contiendra à nouveau tous les trois à la fois? | Multiples de 6 : 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72, ... Multiples de 8 : 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, ... Multiples de 9 : 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, ... PPCM = 72 (Réponse : casier 72) |
| 3 | Trouve un nombre premier entre 60 et 69. | 61 ou 67 |
| 4 | Le nombre 279 est composé. Trouve un nombre autre que 1 et lui-même, qui serait un des facteurs de 279. | 3, 9, 31 ou 93 |
| 5 | Lequel de ces nombres est divisible par 4? 386, 418, 568, 694 | 568 |
| 6 | Lequel de ces nombres est divisible par 6? 496, 246, 589, 634 | 246 |
| 7 | À quel nombre standard équivaut le nombre douze au carré? | 122 = 12 x 12 = 144 |
| 8 | À quel nombre standard équivaut le nombre huit au cube? | 83 = 8 x 8 x 8 = 512 |
| 9 | Les nombres 1, 7, 49, 343, ... sont tous des puissances de 7. Quel est le prochain nombre de cette suite? (N'insère ni espaces ni virgules dans ta réponse.) | 2401 |
| 10 | Si deux élevé à la puissance onze est égal à 2 048, alors combien fait deux élevé à la puissance douze?(N'insère ni espaces ni virgules dans ta réponse.) | 212 = 211 x 2 = 2048 x 2 = 4096 |
| Traduction par Natmark-ConceptMC, Laval (Québec) Canada. | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Recommandez cette leçon! |
22:23 | Lien permanent | Commentaires (2) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Théorie des nombres: comptes rendus de la Conférence internationale de ... Par Jean-Marie De Koninck,Claude Lévesque Livre
22:16 | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Théorie des nombres, Volume 2 Par Adrien Marie Legendre Livre
22:14 | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Arakelov Geometry Preprint Archive
Arakelov Geometry Preprint Archive
Source : http://people.math.jussieu.fr/~vmaillot/Arakelov/
22:10 | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Prépublications Publications de Pierre Colmez
22:02 | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
éléments d'analyse et d'algèbre Livre
22:00 | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Sommes de séries de nombres réels
Sommes de séries de nombres réels
SOURCES : http://images.math.cnrs.fr/Sommes-de-series-de-nombres-re...
Le 13 octobre 2010, par Jean-Paul Allouche
Directeur de Recherche au CNRS, Université Paris 6 (page web)
Les séries de nombres réels m’ont toujours fasciné. Qu’est-ce qu’une série ? C’est un peu comme une somme, mais où, au lieu d’ajouter deux termes ou un nombre fini de termes, on veut ajouter une infinité de termes ! Les problèmes les plus divers, du calcul de certaines aires par Archimède [1] à l’étude de certaines fonctions par Euler [2] ont donné lieu à de telles expressions (et les sources ne sont pas taries aujourd’hui - comme nous essaierons de le montrer avec quelques exemples récents à la fin de cet article).
ECRIVONS quelques séries pour nous mettre en appétit.


 +14n+
+14n+

 C=11+21+31+41+
C=11+21+31+41+

 +1n+
+1n+

 E=11+41+91+116+
E=11+41+91+116+

 +1n2+
+1n2+

 B=21+41+81+116+
B=21+41+81+116+

 +12n+
+12n+

 D=11−21+31−41+
D=11−21+31−41+

 +n(−1)n+1+
+n(−1)n+1+

 F=1−1
F=1−1 2+1
2+1 2
2 3−1
3−1 2
2 3
3 4+
4+

 +(−1)n+1n!+
+(−1)n+1n!+


On peut admirer l’esthétique formelle de ces expressions, voire leur aspect ésotérique. Les séries sont surtout l’un des procédés dont dispose l’analyse pour définir et calculer de nouveaux nombres, parfois mystérieux comme  (pi) ou la constante d’Euler
(pi) ou la constante d’Euler  (gamma) que nous verrons plus loin. Tout cela seulement à partir des entiers, des quatre opérations et... de l’infini.
(gamma) que nous verrons plus loin. Tout cela seulement à partir des entiers, des quatre opérations et... de l’infini.
Comment donner un sens à une « somme infinie » ?
On sait ajouter deux nombres ; en répétant cette opération on peut calculer la somme d’un nombre fini de nombres. Mais comment pourrait-on ajouter entre eux une infinité de nombres ? Si vous ne voyez pas, vous avez raison : il faut choisir (intelligemment) le sens que l’on souhaite donner à ces expressions, comme l’avait compris Euler et comme l’ont clarifié Cauchy et Bolzano au dix-neuvième siècle.
Considérons la série A ci-dessus. On peut tenter d’ajouter entre eux des termes en nombre de plus en plus grand, mais fini : on obtient ce qu’on appelle les sommes partielles de la série (où le nième terme est appelé le terme général de la série). Pour le premier exemple ci-dessus, les sommes partielles avec 1 2
2 3
3 6 et 10 termes sont (à 10−4 près, c’est-à-dire avec une précision de quatre chiffres après la virgule) :
6 et 10 termes sont (à 10−4 près, c’est-à-dire avec une précision de quatre chiffres après la virgule) :
 A2=1+41=1
A2=1+41=1 25
25 A3=1+41+116=1
A3=1+41+116=1 3125
3125 A6=1
A6=1 3330
3330


 A10=1
A10=1 3333
3333


En continuant les calculs, les valeurs obtenues semblent se stabiliser autour de 4 3=1
3=1 333333333
333333333

 On dit que la série converge vers la valeur4
On dit que la série converge vers la valeur4 3 qui est appelée la somme de la série. (Pour les lecteurs plus avertis signalons que nous avons écrit « stabilisation » pour existence d’une limite.) C’est en calculant cette somme qu’Archimède a montré que l’aire entre la parabole d’équation y=x2 et la courbe y=1 vaut 4
3 qui est appelée la somme de la série. (Pour les lecteurs plus avertis signalons que nous avons écrit « stabilisation » pour existence d’une limite.) C’est en calculant cette somme qu’Archimède a montré que l’aire entre la parabole d’équation y=x2 et la courbe y=1 vaut 4 3.
3.
Comme Monsieur Jourdain faisait de la prose sans le savoir, nous manipulions certaines séries sans le savoir quand nous écrivions à l’école4
 3=1
3=1 33333
33333

 En effet, l’écriture de 4
En effet, l’écriture de 4 3 sous la forme « 1 », une virgule, puis une infinité de « 3 », signifie précisément :
3 sous la forme « 1 », une virgule, puis une infinité de « 3 », signifie précisément :


 +310n+
+310n+


Les sommes partielles sont 1 puis 1+3 10=1
10=1 3 puis 1+3
3 puis 1+3 10+3
10+3 100=1
100=1 33 etc., et elles s’approchent de plus en plus de 4
33 etc., et elles s’approchent de plus en plus de 4 3.
3.
Cette définition de la somme d’une série ne permet pas de donner un sens à toutes les séries. En effet, la « stabilisation » que nous évoquions n’a pas toujours lieu. Dans le cas de la série F par exemple :
 F2=−1
F2=−1 F3=5
F3=5 F4=−19
F4=−19 F5=101
F5=101



Les sommes partielles ne se stabilisent pas. On dit que la série F diverge.
Un galop d’essai
Commençons par ce qui est peut-être la plus simple des séries, la série


 +12n+
+12n+


Même sans connaître la valeur de la somme des n premiers termes d’une progression géométrique, on « voit » que cette série converge et que sa somme est 1 : imaginer un seau de volume 1 qu’on remplit à moitié, puis on remplit la moitié de cette moitié, puis la moitié de cette dernière quantité etc. : on voit qu’on va « finir » par remplir entièrement le seau :
On voit en particulier qu’à chaque étape le reste à remplir est égal à la dernière quantité versée : ce reste devient arbitrairement petit et le volume d’eau dans le seau tend vers le volume du seau. Ce raisonnement intuitif peut être transformé en une démonstration rigoureuse.
Un exemple un peu étonnant (?)
L’exemple suivant m’a beaucoup interloqué lorsque je le vis pour la première fois. Il s’agit de la série


 +1n+
+1n+


appelée série harmonique. L’écriture ci-dessus signifie que le nième terme vaut 1 n.
n.
Si on utilise une calculatrice pour calculer cette somme (ce que je ne me suis pas privé de faire il y a de nombreuses années — y compris sur les calculatrices programmables qui faisaient alors juste leur apparition), on a l’impression que la série converge, mais très lentement et que, de plus, sa somme... dépend de la calculatrice, ce qui fait un peu désordre.
Les lecteurs sont invités à faire ce calcul sur des machines variées, avec des méthodes variées et des précisions tout aussi variées. Ils obtiendront sans doute d’autres valeurs (ainsi que certains calculs interminables, par exemple en « double précision »).
En fait, tous ces résultats sont absurdes, ce qui explique qu’ils dépendent des détails de la mise en place du calcul. Mathématiquement, la quantité

 devient arbitrairement grande (on dit qu’elle « tend vers l’infini ») et donc la série ne converge vers aucun nombre : elle diverge.
devient arbitrairement grande (on dit qu’elle « tend vers l’infini ») et donc la série ne converge vers aucun nombre : elle diverge.
Le lecteur astucieux pourra peut-être démontrer que cette « pseudo-convergence expérimentale » se produit pour toutes les séries divergentes dont le terme général tend vers zéro (la stabilisation expérimentale est d’autant moins rapide que la précision est grande et la décroissance des termes lente).
Un exemple « magique » ?
La série qui m’a le plus « passionné » ensuite est la série



Démontrer que cette série converge est relativement aisé. Il suffit de comparer cette série à la série
 2+12
2+12 3+13
3+13 4+14
4+14 5+
5+


comme expliqué dans l’onglet ci-dessous. Ceci compris, Pietro Mangoli pose en 1644 le problème de la détermination de la valeur de cette série. Comme souvent en mathématiques, construire quelque chose est plus difficile que d’en prouver l’existence et le problème de Mangoli résiste aux efforts des mathématiciens pendant... 93 ans.
Le calcul approché de la valeur de la série E=112+122+132+142+

 est infaisable à la main. Il est certes aujourd’hui facile de sommer plus de dix mille termes pour avoir quatre malheureux chiffres après la virgule : E=1
est infaisable à la main. Il est certes aujourd’hui facile de sommer plus de dix mille termes pour avoir quatre malheureux chiffres après la virgule : E=1 6449
6449 10−4. En 1731, l’astuce ne manque pas et on [3] obtient la valeur approchée :
10−4. En 1731, l’astuce ne manque pas et on [3] obtient la valeur approchée :
 64493406684822643
64493406684822643 10−18
10−18Quel est donc ce nombre mystère ?
Ce n’est qu’en 1735 qu’un jeune prodige de 28 ans, Léonard Euler étonne le monde scientifique en déterminant enfin la valeur, remarquable, de cette série :


 =6
=6 2
2
Pour démontrer cette égalité on dispose depuis le dix-neuvième siècle d’une méthode générale utilisant des « séries de Fourier » [4]. On peut également utiliser, comme Euler, des méthodes plus élémentaires, par exemple s’appuyant sur des inégalités trigonométriques : du coup l’apparition de  est (peut-être) moins étonnante que lorsque l’on contemple la somme des inverses des carrés des entiers.
est (peut-être) moins étonnante que lorsque l’on contemple la somme des inverses des carrés des entiers.
Un peu de théorie des nombres
Quelle est la nature de la valeur de la série précédente E= 2
2 6 ? c’est une question de théorie des nombres.
6 ? c’est une question de théorie des nombres.
La série, E définie en multipliant, en divisant et en additionnant des nombres entiers, a pour somme  2
2 6. Or on peut montrer que
6. Or on peut montrer que  2
2 6, comme
6, comme  , n’est pas un nombre rationnel (on dit que c’est un nombre irrationnel) : ceci signifie qu’il ne peut s’obtenir comme le rapport de deux entiers, ni donc à partir des entiers par un nombre fini d’additions, de multiplications ou de divisions. Son apparition dans la valeur de E est une illustration de la puissance créatrice du passage à la limite.
, n’est pas un nombre rationnel (on dit que c’est un nombre irrationnel) : ceci signifie qu’il ne peut s’obtenir comme le rapport de deux entiers, ni donc à partir des entiers par un nombre fini d’additions, de multiplications ou de divisions. Son apparition dans la valeur de E est une illustration de la puissance créatrice du passage à la limite.
On a même davantage,  2
2 6, comme
6, comme  , est un nombre transcendant : on ne peut pas l’obtenir à partir des entiers même en rajoutant aux additions, multiplications et divisions, la recherche de racines de polynômes à coefficients entiers (par exemple,
, est un nombre transcendant : on ne peut pas l’obtenir à partir des entiers même en rajoutant aux additions, multiplications et divisions, la recherche de racines de polynômes à coefficients entiers (par exemple,  n’est la racine carré d’aucun nombre rationnel). Démontrer que
n’est la racine carré d’aucun nombre rationnel). Démontrer que  (ou
(ou  2
2 6) est irrationnel, et même transcendant, dépasse de beaucoup ce qu’on peut expliquer dans un article comme celui-ci.
6) est irrationnel, et même transcendant, dépasse de beaucoup ce qu’on peut expliquer dans un article comme celui-ci.
Le résultat d’Euler se généralise aux puissances entières paires supérieures à 2 :


 =90
=90 4
4

 =
= 6945
6945

 =
= 89450
89450

 =
= 1093555
1093555


Ces valeurs sont encore des puissances de  divisées par des rationnels (et même par des entiers dans les exemples ci-dessus) et elles sont, comme
divisées par des rationnels (et même par des entiers dans les exemples ci-dessus) et elles sont, comme  2
2 6, transcendantes (a fortiori irrationnelles).
6, transcendantes (a fortiori irrationnelles).
On ne peut finir ce paragraphe sans signaler qu’on ne sait que peu de choses sur les sommes des séries analogues où les exposants2 4
4 6
6 8
8 10
10

 sont remplacés par 3
sont remplacés par 3 5
5 7
7 9
9 11
11

 . Citons au moins un résultat d’Apéry qui date de 1978 et qui stipule que 113+123+133+
. Citons au moins un résultat d’Apéry qui date de 1978 et qui stipule que 113+123+133+

 est irrationnel : nos lecteurs les plus téméraires en trouveront une belle exposition dans l’article de van der Poorten [vdP-79].
est irrationnel : nos lecteurs les plus téméraires en trouveront une belle exposition dans l’article de van der Poorten [vdP-79].
On suppose, sans savoir le démontrer, que les sommes des séries avec les exposants 5 7
7 9
9 11
11 13
13

 sont irrationnelles (et même transcendantes). Mais, on n’a que des résultats partiels :
sont irrationnelles (et même transcendantes). Mais, on n’a que des résultats partiels :
- d’après un résultat de Ball et Rivoal (voir [BR-01], voir aussi [T-00] et sa version prétirage librement consultable) une infinité de ces valeurs sont irrationnelles.
- d’après un résultat de Zudilin [Z-04], au moins l’une des quatre sommes avec les exposants 5
 7
7 9
9 11 est irrationnelle.
11 est irrationnelle.
On ne sait pas démontrer cette irrationalité pour tous les exposants impairs, ce qui fait de la supposition ci-dessus ce que les mathématiciens appellent une conjecture : une assertion importante, dont on soupçonne la véracité au vu de ce qu’on a déjà analysé mais dont on cherche encore la preuve...
Utiliser la série E=1+1 4+1
4+1 9+
9+

 pour calculer
pour calculer  serait une très mauvaise idée : comme on l’a souligné, il faut énormément de termes pour approcher
serait une très mauvaise idée : comme on l’a souligné, il faut énormément de termes pour approcher  avec une grande précision. D’autres séries ne souffrent pas de ce défaut. Donnons-en un exemple dû à Ramanujan, l’un des mathématiciens les plus célèbres du vingtième siècle. C’est l’une des (nombreuses) séries « magiques » qu’il a découvertes :
avec une grande précision. D’autres séries ne souffrent pas de ce défaut. Donnons-en un exemple dû à Ramanujan, l’un des mathématiciens les plus célèbres du vingtième siècle. C’est l’une des (nombreuses) séries « magiques » qu’il a découvertes :
 29801
29801 0!4
0!4 3964
3964 00!(1103+(26390
00!(1103+(26390 0))+1!4
0))+1!4 3964
3964 14!(1103+(26390
14!(1103+(26390 1))+2!4
1))+2!4 3964
3964 28!(1103+(26390
28!(1103+(26390 2))+
2))+


 2
2 29801
29801
 k=0(k!)43964k(4k)!(1103+26390k)
k=0(k!)43964k(4k)!(1103+26390k) où 
 k=0zk signifie z0+z1+z2+
k=0zk signifie z0+z1+z2+

 et m! désigne la factorielle m, c’est-à-dire le produit 1
et m! désigne la factorielle m, c’est-à-dire le produit 1 2
2 3
3

 m.
m.
La rapidité de la convergence de R est stupéfiante : 1 R1 ne diffère de
R1 ne diffère de  que de moins de 10−7 et chaque terme supplémentaire fait gagner huit ordres de grandeur à la précision ! (1
que de moins de 10−7 et chaque terme supplémentaire fait gagner huit ordres de grandeur à la précision ! (1 R2 est indistinguable de
R2 est indistinguable de  pour les procédés de calculs ordinaires en « simple précision »).
pour les procédés de calculs ordinaires en « simple précision »).
Des séries avec la somme des chiffres des entiers
On peut trouver de nombreuses séries convergentes dont on sait exprimer de manière « simple » et parfois inattendue la somme. Voici encore deux exemples classiques :


 =log2
=log2(ce dernier nombre est le logarithme naturel de 2 et vaut 0 693147
693147

 ) et, maintenant en se restreignant aux entiers impairs, surprise :
) et, maintenant en se restreignant aux entiers impairs, surprise :


 =4
=4

Ce sont deux nombres transcendants dont le rapprochement peut paraître insolite. L’analyse complexe permettrait d’expliquer leur cousinage mais cela nous entraînerait un peu trop loin.
Nous donnons maintenant un exemple peut-être non conventionnel.
Notons s(k) la somme des chiffres du développement décimal de l’entier k (par exemple si k=23, on a s(k)=5). Alors la série de terme général s(k)k(k+1) converge et sa somme est 910log10. Autrement dit
 2s(1)+2
2s(1)+2 3s(2)+3
3s(2)+3 4s(3)+4
4s(3)+4 5s(4)+
5s(4)+

 =11
=11 2+12
2+12 3+23
3+23 4++14
4++14 5+
5+

 =910log10
=910log10
Les lecteurs trouveront des séries du même genre dans l’article [ASS-07] (voir aussi la version prétirage de cet article). Nous ne résisterons pas au plaisir de citer deux autres de ces séries que l’on trouvera dans un article de Sondow : soit N1(n) (respectivement N0(n)) le nombre de 1(respectivement de 0) dans le développement binaire de l’entier n. Alors la constante d’Euler  (que nous avons déjà vue ici) et ce que Sondow appelle la constante d’Euler « alternée »
(que nous avons déjà vue ici) et ce que Sondow appelle la constante d’Euler « alternée »  − que l’on peut définir respectivement par
− que l’on peut définir respectivement par
 :=
:= n
n 1
1 1n−lnnn+1
1n−lnnn+1
(comme vu plus haut) et
 −:=
−:= n
n 1(−1)n−1
1(−1)n−1 1n−lnnn+1
1n−lnnn+1 =log
=log 4
4

permettent de donner la somme des deux séries ci-dessous :
 n
n 12n(2n+1)N1(n)+N0(n)=
12n(2n+1)N1(n)+N0(n)=
et
 n
n 12n(2n+1)N1(n)−N0(n)=
12n(2n+1)N1(n)−N0(n)= −
− d’où l’on tire aussi
 n
n 1s2(n)2n(2n+1)=2
1s2(n)2n(2n+1)=2 +log4
+log4
où s2(n) est la somme des chiffres binaires de l’entier n. On conjecture qu’aussi bien  que
que  − sont irrationnels (et même que
− sont irrationnels (et même que  et
et  − sont transcendants) mais cette conjecture est toujours ouverte.
− sont transcendants) mais cette conjecture est toujours ouverte.
Un mot sur les produits infinis
De même qu’on s’est intéressé ci-dessus à des expressions du genre u1+u2+u3+

 , de même on peut s’intéresser à des produits infinis du genre u1
, de même on peut s’intéresser à des produits infinis du genre u1 u2
u2 u3
u3


 . Si l’on suppose que tous les facteurs du produit sont strictement positifs, prendre le logarithme permet de se ramener à l’étude de séries : en effet il suffit d’écrire log(u1
. Si l’on suppose que tous les facteurs du produit sont strictement positifs, prendre le logarithme permet de se ramener à l’étude de séries : en effet il suffit d’écrire log(u1 u2
u2



 un)=logu1+logu2+
un)=logu1+logu2+

 +logun. Et pourtant, comme pour les séries par rapport aux suites, les produits infinis ont un intérêt propre.
+logun. Et pourtant, comme pour les séries par rapport aux suites, les produits infinis ont un intérêt propre.
Nous nous contenterons d’allécher (peut-être) nos lecteurs avec deux exemples. Le premier est dû à Viète (1540-1603, il est considéré de nos jours comme le premier ou l’un des tout premiers algébristes modernes), et c’est semble-t-il l’un des premiers exemples historiques de produits infinis
 2
2 2
2 2+
2+ 2
2 2
2 2+
2+ 2+
2+ 2
2

 =2
=2

Le second exemple que nous donnerons ici est peut-être peu connu. Définissons la suite (a(n)) par
- a(n)=1 si la somme des chiffres de l’entier n en base 2 est paire,
- a(n)=−1 si cette somme est impaire.
(Par exemple si n = treize, treize s’écrit 1101 en base 2, donc a(13)=−1, et si n = quinze, quinze s’écrit 1111 en base 2, donc a(15)=+1.) On conviendra aussi que a(0):=1. Alors
 21
21 a(0)
a(0)
 43
43 a(1)
a(1)
 65
65 a(2)
a(2)


 =2
=2 2
2
Les lecteurs pourront s’amuser à vérifier que les produits partiels sont respectivement
 2 3
2 3 41
41 2 7
2 7 85
85 63
63 41
41 2
2 


Conclusion
Je ne sais pas si (mais j’espère que) des lecteurs auront été « fascinés », intéressés ou même amusés par ces exemples. Je signalerai seulement pour finir comme référence sur la Toile pour des séries ou produits infinis non conventionnels la page de J. Sondow.
Remerciement : L’auteur tient à remercier toutes les personnes qui ont relu le texte initial, avec une mention particulière pour G. Jouve et F. Le Roux qui ont suggéré plusieurs améliorations, et une mention spéciale pour J. Buzzi, qui a considérablement enrichi cet article.
Courte bibliographie
[ASS-07] J.-P. Allouche, J. Shallit, J. Sondow, Summation of series defined by counting blocks of digits, Journal of Number Theory 123(2007), 133-143.
[BR-01] K. Ball, T. Rivoal, Irrationalité d’une infinité de valeurs de la fonction zêta aux entiers impairs, Inventiones Mathematica 146 (2001), 193-207.
[Coppo] M. A. Coppo, Une histoire des séries infinies d’Oresme à Euler, Gazette des Mathématiciens 120 (2009), 39-52.
[DMFP-82] F. M. Dekking, M. Mendès France, A. van der Poorten, Folds!, The Mathematical Intelligencer 4 (1982), 130-138, 173-181, 190-195.
[T-00] T. Rivoal, La fonction zêta de Riemann prend une infinité de valeurs irrationnelles aux entiers impairs, Comptes Rendus de l’Académie des Sciences, Paris, Série I, Mathématiques 331 (2000), 267-270.
[S-80] K. B. Stolarsky, Mapping properties, growth, and uniqueness of Vieta (infinite cosine) products, Pacific J. Math. 89 (1980), 209-227.
[vdP-79] A. van der Poorten, A proof that Euler missed... Apéry’s proof of the irrationality of zeta(3), The Mathematical Intelligencer 1 (1979), 195-203.
[Z-04] W. Zudilin, Arithmetic of linear forms involving odd zeta values, Journal de Théorie des Nombres de Bordeaux 16 (2004), 251-291.
La rédaction d’Images des maths, ainsi que l’auteur, remercient pour leur relecture attentive, les relecteurs dont le pseudonyme est le suivant : Frédéric Le Roux, Guillaume Jouve, chuy .
Notes
[1] Archimède (287 avant J.C. - 212 avant J.C.).
[2] Leonard Euler (1707-1783).
[3] Cette estimation est également due à Euler.
[4] Joseph Fourier, mathématicien et préfet (1768-1830). La théorie des séries de Fourier permet d’écrire une fonction comme une série de fonctions sinus et cosinus multipliées par des constantes. Ces fonctions trigonométriques font intervenir le nombre  .
.
Il y a 8 commentaires ...
21:56 Publié dans Sommes de séries de nombres réels | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
THÉORIE DE LA DÉMONSTRATION
|
1. THÉORIE DE LA DÉMONSTRATION |
Version: 2.1 Revision 2 | Rédacteur: Vincent Isoz | Avancement: ~80%
![]() LISTE DES SUJETS TRAITÉS SUR CETTE PAGE
LISTE DES SUJETS TRAITÉS SUR CETTE PAGE
SOURCE : http://www.sciences.ch/htmlfr/arithmetique/arithmetiqueth...
Nous avons choisi de commencer l'étude de la mathématique appliquée par la théorie qui nous semble la plus fondamentale et la plus importante dans le domaine des sciences pures et exactes.
La théorie de la démonstration et du calcul propositionnel (logique) a trois objectifs dans le cadre de ce site :
1. Apprendre au lecteur comment raisonner et à démontrer et cela indépendamment de la spécialisation étudiée
2. Montrer que le processus d'une démonstration est indépendante du langage utilisé
3. Se préparer à la théorie de la logique et au théorème d'incomplétude de Gödel ainsi qu'aux automates (cf. chapitre d'Informatique Théorique).
Le théorème de Gödel est le point le plus passionnant car si nous définissons une religion comme un système de pensée qui contient des affirmations indémontrables, alors elle contient des éléments de foi, et Gödel nous enseigne que les mathématiques sont non seulement une religion, mais que c'est alors la seule religion capable de prouver qu'elle en est une!
R1. Il est (très) fortement conseillé de lire en parallèle à ce chapitre, ceux sur la théorie des automates et de l'algèbre de Boole disponibles dans la section d'Informatique Théorique du site.
R2. Il faut prendre cette théorie comme une curiosité sympathique mais qui n'amène fondalement pas grand chose excepté des méthodes de travail/raisonnement. Par ailleurs, son objectif n'est pas de démontrer que tout est démontrable mais que toute démonstration peut se faire sur un langage commun à partir d'un certain nombre de règles.
Souvent, quand un étudiant arrive dans une classe supérieure, il a surtout appris à calculer, à utiliser des algorithmes mais relativement peu voire pas du tout à raisonner. Pour tous les raisonnements, le support visuel est un outil puissant, et les personnes qui ne voient pas qu'en traçant telle ou telle courbe droite la solution apparaît ou qui ne voient pas dans l'espace sont très pénalisées.
Lors des études secondaires, nous manipulons déjà des objets inconnus, mais c'est surtout pour faire des calculs, et quand nous raisonnons sur des objets représentés par des lettres, nous pouvons remplacer ceux-ci visuellement par un nombre réel, un vecteur, etc. A partir d'un certain niveau, nous demandons aux personnes de raisonner sur des structures plus abstraites, et donc de travailler sur des objets inconnus qui sont des éléments d'un ensemble lui-même inconnu, par exemple les éléments d'un groupe quelconque (cf. chapitre de Théorie Des Ensembles). Ce support visuel n'existe alors plus.
Nous demandons ainsi souvent aux étudiants de raisonner, de démontrer des propriétés, mais personne ne leur a jamais appris à raisonner convenablement, à écrire des preuves. Si nous demandons à un étudiant de licence ce qu'est une démonstration, il a très probablement quelque difficulté à répondre. Il peut dire que c'est un texte dans lequel on trouve des "mots clés": "donc", "parce que", "si", "si et seulement si", "prenons un x tel que", "supposons que", "cherchons une contradiction", etc. Mais il est incapable de donner la grammaire de ces textes ni même ces rudiments, et d'ailleurs, ses enseignants, s'ils n'ont pas suivi de cours, en seraient probablement incapables aussi.
Pour comprendre cette situation, rappelons que pour parler un enfant n'a pas besoin de connaître la grammaire. Il imite son entourage et cela marche très bien : un enfant de six ans sait utiliser des phrases déjà compliquées quant à la structure grammaticale sans avoir jamais fait de grammaire. La plupart des enseignants ne connaissent pas non plus la grammaire du raisonnement mais, chez eux, le processus d'imitation a bien marché et ils raisonnent correctement. L'expérience de la majorité des enseignants d'université montre que ce processus d'imitation marche bien chez les très bons étudiants, et alors il est suffisant, mais il marche beaucoup moins bien, voire pas du tout, chez beaucoup d'autres.
Tant que le degré de complexité est faible (notamment lors d'un raisonnement de type "équationnel"), la grammaire ne sert à rien, mais quand il augmente ou quand on ne comprend pas pourquoi quelque chose est faux, il devient nécessaire de faire un peu de grammaire pour pouvoir progresser. Les enseignants et les étudiants connaissent bien la situation suivante: dans un devoir, le correcteur a barré toute une page d'un grand trait rouge et mis "faux" dans la marge. Quand l'étudiant demande ce qui est faux, le correcteur ne peut que dire des choses du genre "ça n'a aucun rapport avec la démonstration demandée", "rien n'est juste", ..., ce qui n'aide évidemment pas l'étudiant à comprendre. Cela vient en partie, du fait que le texte rédigé par l'étudiant utilise les mots voulus mais dans un ordre plus ou moins aléatoire et qu'on ne peut donner de sens à l'assemblage de ces mots. De plus, l'enseignant n'a pas les outils nécessaires pour pouvoir expliquer ce qui ne va pas. Il faut donc les lui donner!
Ces outils existent mais sont assez récents. La théorie de la démonstration est une branche de la logique mathématique dont l'origine est la crise des fondements : il y a eu un doute sur ce que nous avions le "droit" de faire dans un raisonnement mathématique (voir la "crise des fondements" plus loin). Des paradoxes sont apparus, et il a alors été nécessaire de préciser les règles de démonstration et de vérifier que ces règles ne sont pas contradictoires. Cette théorie est apparue au début du 20ème siècle, ce qui est très peu puisque l'essentiel des mathématiques enseignées en première moitié de l'université est connu depuis le 16ème-17ème siècle.
LA CRISE DES FONDEMENTS
Pour les premiers Grecs, la géométrie était considérée comme la forme la plus haute du savoir, une puissante clé pour les mystères métaphysiques de l'Univers. Elle était plutôt une croyance mystique, et le lien entre le mysticisme et la religion était rendu explicite dans des cultes comme ceux des Pythagoriciens. Aucune culture n'a depuis déifié un homme pour avoir découvert un théorème géométrique! Plus tard, les mathématiques furent considérées comme le modèle d'une connaissance a priori dans la tradition aristotélicienne du rationalisme.
L'étonnement des Grecs pour les mathématiques ne nous a pas quitté, on le retrouve sous la traditionnelle métaphore des mathématiques comme "Reine des Science". Il s'est renforcé avec les succès spectaculaires des modèles mathématiques dans la science, succès que les Grecs (ignorant même la simple algèbre) n'avaient pas prévus. Depuis la découverte par Isaac Newton du calcul intégral et de la loi du carré inverse de la gravité, à la fin des années 1600, les sciences phénoménales et les plus hautes mathématiques étaient restées en étroite symbiose - au point qu'un formalisme mathématique prédictif était devenu le signe distinctif d'une "science dure".
Après Newton, pendant les deux siècles qui suivirent, la science aspira à ce genre de rigueur et de pureté qui semblaient inhérentes aux mathématiques. La question métaphysique semblait simple: les mathématiques possédaient une connaissance a priori parfaite, et parmi les sciences, celles qui étaient capables de se mathématiser le plus parfaitement étaient les plus efficaces pour la prédiction des phénomènes. La connaissance parfaite consistait donc dans un formalisme mathématique qui, une fois atteint par la science et embrassant tous les aspects de la réalité, pouvait fonder une connaissance empirique a postériori sur une logique rationnelle a priori. Ce fut dans cet esprit que Jean-Antoine Nicolas de Cartitat, marquis de Condorcet (philosophe et mathématicien français), entreprit d'imaginer la description de l'Univers entier comme un ensemble d'équation différentielles partielles se résolvant les unes après les autres.
La première faille dans cette image inspiratrice apparut dans la seconde moitié du 19ème siècle, quand Riemann et Lobachevsky prouvèrent séparément que l'axiome des parallèles d'Euclides pouvait être remplacé par d'autres qui produisaient des géométries "consistantes" (nous reviendrons sur ce terme plus loin). La géométrie de Riemann prenait modèle sur une sphère, celle de Lobachevsky, sur la rotation d'un hyperboloïde.
L'impact de cette découverte a été obscurci plus tard par de grands chamboulements, mais sur le moment, il fut un coup de tonnerre dans le monde intellectuel. L'existence de systèmes axiomatiques mutuellement inconsistants, et dont chacun pouvait servir de modèle à l'Univers phénoménal, remettait entièrement en question la relation entre les mathématiques et la théorie physique.
Quand on ne connaissait qu'Euclide, il n'y avait qu'une géométrie possible. On pouvait croire que les axiomes d'Euclide constituaient un genre de connaissance parfaite a priori sur la géométrie dans le monde phénoménal. Mais soudain, nous avons eu trois géométries, embarrassantes pour les subtilités métaphysiques.
Pourquoi aurions-nous à choisir entre les axiomes de la géométrie plane, sphérique et hyperbolique comme descriptions de la géométrie du réel? Parce que toutes les trois sont consistantes, nous ne pouvons en choisir aucune comme fondement a priori - le choix doit devenir empirique, basé sur leur pouvoir prédictif dans une situation donnée.
Bien sûr, Les théoriciens de la physique ont longtemps été habitués à choisir des formalismes pour poser un problème scientifique. Mais il était admis largement, si ce n'est inconsciemment, que la nécessité de procéder ainsi était fonction de l'ignorance humaine, et qu'avec de la logique ou des mathématiques assez bonnes, on pouvait déduire le bon choix à partir de premiers principes, et produire des descriptions à priori de la réalité, qui devaient être confirmées après coup par une vérification empirique.
Cependant, la géométrie euclidienne, considérée pendant plusieurs centaines d'années comme le modèle de la perfection axiomatique des mathématiques, avait été détrônée. Si l'on ne pouvait connaître a priori quelque chose d'aussi fondamental que la géométrie dans l'espace, quel espoir restait-il pour une pure théorie rationnelle qui embrasserait la totalité de la nature ? Psychologiquement, Riemann et Lobachevsky avaient frappé au coeur de l'entreprise mathématique telle qu'elle avait été conçue jusqu'alors.
De plus, Riemann et Lobachevsky remettaient la nature de l'intuition mathématique en question. Il avait été facile de croire implicitement que l'intuition mathématique était une forme de perception - une façon d'entrevoir le monde platonicien derrière la réalité. Mais avec deux autres géométries qui bousculaient celle d'Euclide, personne ne pouvait plus être sûr de savoir à quoi le monde ressemblait.
Les mathématiciens répondirent à ce double problème avec un excès de rigueur, en essayant d'appliquer la méthode axiomatique à toutes les mathématiques. Dans la période pré-axiomatique, les preuves reposaient souvent sur des intuitions communément admises de la "réalité" mathématique, qui ne pouvaient plus être considérées automatiquement comme valides.
La nouvelle façon de penser les mathématiques conduisait à une série de succès spectaculaires. Pourtant cela avait aussi un prix. La méthode axiomatique rendait la connexion entre les mathématiques et la réalité phénoménale toujours plus étroite. En même temps, des découvertes suggéraient que les axiomes mathématiques qui semblaient être consistants avec l'expérience phénoménale pouvait entraîner de vertigineuses contradictions avec cette expérience.
La majorité des mathématiciens devinrent rapidement des "formalistes", soutenant que les mathématiques pures ne pouvaient qu'être considérées philosophiquement comme une sorte de jeu élaboré qui se jouait avec des signes sur le papier (c'est la théorie qui sous-tend la prophétique qualification des mathématiques de "système à contenu nul" par Robert Heinlein). La croyance "platonicienne" en la réalité des objets mathématiques, à l'ancienne manière, semblait bonne pour la poubelle, malgré le fait que les mathématiciens continuaient à se sentir comme les platoniciens durant le processus de découverte des mathématiques.
Philosophiquement, donc, la méthode axiomatique conduisait la plupart des mathématiciens à abandonner les croyances antérieures en la spécificité métaphysique des mathématiques. Elle produisit aussi la rupture contemporaine entre les mathématiques pures et appliquées. La plupart des grands mathématiciens du début de la période moderne - Newton, Leibniz, Fourier, Gauss et les autres - s'occupaient aussi de science phénoménale. La méthode axiomatique avait couvé l'idée moderne du mathématicien pur comme un super esthète, insoucieux de la physique. Ironiquement, le formalisme donnait aux purs mathématiciens un mauvais penchant à l'attitude platonicienne. Les chercheurs en mathématiques appliquées cessèrent de côtoyer les physiciens et apprirent à se mettre à leur traîne.
Ceci nous emmène au début du 20ème siècle. Pour la minorité assiégée des platoniciens, le pire était encore à venir. Cantor, Frege, Russell et Whitehead montrèrent que toutes les mathématiques pures pouvaient être construites sur le simple fondement axiomatique de la théorie des ensembles. Cela convenait parfaitement aux formalistes: les mathématiques se réunifiaient, du moins en principe, à partir d'un faisceau de petits jeux détachés d'un grand. Les platoniciens aussi étaient satisfaisaits, sil en survenait une grande structure, clé de voûte consistante pour toutes les mathématiques, la spécificité métaphysique des mathématiques pouvait encore être sauvée.
D'une façon négative, pourtant, un platonicien eut le dernier mot. Kurt Gödel mit son grain de sable dans le programme formaliste d'axiomatisation quand il démontra que tout système d'axiomes assez puissant pour inclure les entiers devait être soit inconsistant (contenir des contradictions) soit incomplet (trop faible pour décider de la justesse ou de la fausseté de certaines affirmations du système). Et c'est plus ou moins où en sont les choses aujourd'hui. Les mathématiciens savent que de nombreuses tentatives pour faire avancer les mathématiques comme une connaissance a priori de l'Univers doivent se heurter à de nombreux paradoxes et à l'impossibilité de décider quel système axiomatique décrit les mathématiques réelles. Ils ont été réduits à espérer que les axiomatisations standard ne soient pas inconsistantes mais incomplètes, et à se demander anxieusement quelles contradictions ou quels théorèmes indémontrables attendent d'être découverts ailleurs.
Cependant, sur le front de l'empirisme, les mathématiques étaient toujours un succès spectaculaire en tant qu'outil de construction théorique. Les grands succès de la physique du 20ème siècle (la relativité générale et la physique quantique) poussaient si loin hors du royaume de l'intuition physique, qu'ils ne pouvaient être compris qu'en méditant profondément sur leurs formalismes mathématiques, et en prolongeant leurs conclusions logiques, même lorsque ces conclusions semblaient sauvagement bizarres. Quelle ironie! Au moment même où la perception mathématique en venait à paraître toujours moins fiable dans les mathématiques pures, elle devenait toujours plus indispensable dans les sciences phénoménales.
À l'opposé de cet arrière-plan, l'applicabilité des mathématiques à la science phénoménale pose un problème plus épineux qu'il n'apparaît d'abord. Le rapport entre les modèles mathématiques et la prédiction des phénomènes est complexe, pas seulement dans la pratique mais dans le principe. D'autant plus complexe que, comme nous le savons maintenant, il y a des façons d'axiomatiser les mathématiques qui s'excluent!
Mais pourquoi existe-t-il seulement de bons choix de modèle mathématique ? C'est à dire, pourquoi y a-t-il un formalisme mathématique, par exemple pour la physique quantique, si productif qu'il prédit réellement la découverte de nouvelles particules observables ?
Pour répondre à cette question nous observerons qu'elle peut, aussi bien, fonctionner comme une sorte de définition. Pour beaucoup de système phénoménaux, de tels formalismes prédictifs exacts n'ont pas été trouvés, et aucun ne semble plausible. Les poètes aiment marmonner sur le coeur des hommes, mais on peut trouver des exemples plus ordinaires : le climat, où le comportement d'une économie supérieure à celle d'un village, par exemple - systèmes si chaotiquement interdépendants que la prédiction exacte est effectivement impossible (pas seulement dans les faits mais en principe).
PARADOXES
Dès l'antiquité, certains logiciens avaient constaté la présence de nombreux paradoxes au sein de la rationalité. En fait, nous pouvons dire que malgré leur nombre, ces paradoxes ne sont que les illustrations d'un petit nombre de structures paradoxales. Attardons nous à exposer à titre de culture générale les plus connus.
![]() Exemples:
Exemples:
E1. Le paradoxe de la classe des classes (Russell)
Il existe deux types de classes : celles qui se contiennent elles-mêmes (ou classes réflexives : la classe des ensembles non-vides, la classe des classes,...) et celles qui ne se contiennent pas elles-mêmes (ou classes irréflexives : la classe des travaux à rendre, la classe des oranges sanguines, ...). La question posée est la suivante : la classe des classes irréflexives est-elle elle même réflexive ou irréflexive? Si elle est réflexive, elle se contient et se trouve rangée dans la classe des classes irréflexives qu'elle constitue, ce qui est contradictoire. Si elle est irréflexive, elle doit figurer dans la classe des classes irréflexives qu'elle constitue et devient ipso facto réflexive, nous sommes face à une nouvelle contradiction.
E2. Le paradoxe du bibliothécaire (Gonseth)
Dans une bibliothèque, il existe deux types de catalogues. Ceux qui se mentionnent eux-mêmes et ceux qui ne se mentionnent pas. Un bibliothécaire doit dresser le catalogue de tous les catalogues qui ne se mentionnent pas eux-mêmes. Arrivé au terme de son travail, notre bibliothécaire se demande s'il convient ou non de mentionner le catalogue qu'il est précisément en train de rédiger. A ce moment, il est frappé de perplexité. Si ne le mentionne pas, ce catalogue sera un catalogue qui ne se mentionne pas et qui devra dès lors figurer dans la liste des catalogues ne se mentionnant pas eux-mêmes. D'un autre côté, s'il le mentionne, ce catalogue deviendra un catalogue qui se mentionne et qui ne doit donc pas figurer dans ce catalogue, puisque celui-ci est le catalogue des catalogues qui ne se mentionnent pas.
E3. Le paradoxe du menteur (variante)
Définissons provisoirement le mensonge comme l'action de formuler une proposition fausse. Le poète crétois Epiménide affirme : "Tous les Crétois sont des menteurs", soit la proposition P. Comment décider de la valeur de vérité de P ? Si P est vraie, comme Epiménide est Crétois, P doit être fausse. Il faut donc que P soit fausse pour pouvoir être vraie, ce qui est contradictoire. P est donc fausse. Remarquons qu'on ne peut pas en déduire, comme dans le véritable paradoxe du menteur, que P doit aussi être vraie.
RAISONNEMENT HYPOTHETICO-DEDUCTIF
Le raisonnement hypothético-déductif est, nous le savons, la capacité qu'a l'apprenant de déduire des conclusions à partir de pures hypothèses et pas seulement d'une observation réelle. C'est un processus de réflexion qui tente de dégager une explication causale d'un phénomène quelconque (nous y reviendrons lors de nos premiers pas en physique). L'apprenant qui utilise ce type de raisonnement commence par formuler une hypothèse et essaie ensuite de confirmer ou d'infirmer son hypothèse selon le schéma synoptique ci-dessous :

(1.1)
La procédure déductive consiste à tenir pour vrai, à titre provisoire, cette proposition première que nous appelons, en logique "le prédicat" (voir plus bas) et à en tirer toutes les conséquences logiquement nécessaires, c'est-à-dire à en rechercher les implications.
![]() Exemple:
Exemple:
Soit la proposition P : "X est un homme", elle implique la proposition suivante Q : X est mortel.
L'expression ![]() (si c'est un homme il est nécessairement mortel) est un implication prédicative (d'où le terme "prédicat"). Il n'y a pas dans cet exemple de cas où nous puissions énoncer P sans Q. Cet exemple est celui d'une implication stricte, telle que nous la trouvons dans le "syllogisme" (figure logique du raisonnement).
(si c'est un homme il est nécessairement mortel) est un implication prédicative (d'où le terme "prédicat"). Il n'y a pas dans cet exemple de cas où nous puissions énoncer P sans Q. Cet exemple est celui d'une implication stricte, telle que nous la trouvons dans le "syllogisme" (figure logique du raisonnement).
CALCUL PROPOSITIONNEL
Le "calcul propositionnel" (ou "logique propositionnelle") est un préliminaire absolument indispensable pour aborder une formation en sciences, philosophie, droit, politique, économie, etc. Ce type de calcul autorise des procédures de décisions ou tests. Ceux-ci permettent de déterminer dans quel cas une expression (proposition) logique est vraie et en particulier si elle est toujours vraie.
Définitions:
D1. Une expression toujours vraie quel que soit le contenu linguistique des variables qui la composent est appelée une "expression valide", une "tautologie", ou encore une "loi de la logique propositionnelle".
D2. Un expression toujours fausse est appelée une "contradiction" ou "antologie"
D3. Une expression qui est parfois vraie, parfois fausse est appelée une "expression contingente"
D4. Nous appelons "assertion" une expression dont nous pouvons dire sans ambiguïté s'il elle est vraie ou fausse.
D5. Le "langage objet" est le langage utilisé pour écrire les expressions logiques.
D6. Le "métalangage" est le langage utilisé pour parler du langage objet dans la langue courante
R1. Il existe des expressions qui ne sont effectivement pas des assertions. Par exemple, l'énoncé : "cet énoncé est faux", est un paradoxe qui ne peut être ni vrai, ni faux.
R2. Soit un expression logique A. Si celle-ci est une tautologie, nous la notons fréquemment ![]() et s'il l'expression est une contradiction, nous la notons
et s'il l'expression est une contradiction, nous la notons ![]() .
.
PROPOSITIONS
Définition: En logique, une "proposition" est une affirmation qui a un sens. Cela veut dire que nous pouvons dire sans ambiguïté si cette affirmation est vraie (V) ou fausse (F). C'est ce que nous appelons le "principe du tiers exclu".
![]() Exemple:
Exemple:
"Je mens" n'est pas une proposition. Si nous supposons que cette affirmation est vraie, elle est une affirmation de sa propre invalidité, donc nous devrions conclure qu'elle est fausse. Mais si nous supposons qu'elle est fausse, alors l'auteur de cette affirmation ne ment pas, donc il dit la vérité, aussi la proposition serait vraie.
Définition: Une proposition en logique binaire (où les propositions sont soit vraies, soit fausses) n'est donc jamais vraie et fausse à la fois. C'est que nous appelons le "principe de non-contradiction".
Ainsi, une propriété sur l'ensemble E des propositions est une application P de E dans l'ensemble des "valeurs de vérité" :
![]() (1.2)
(1.2)
Nous parlons de "sous-ensemble associé", lorsque la proposition engendre uniquement une partieE' de E et inversement.
![]() Exemple:
Exemple:
Dans ![]() , si P(x) s'énonce "x est pair" , alors
, si P(x) s'énonce "x est pair" , alors ![]() ce qui est bien seulement un sous-ensemble associé de E mais de même cardinal (cf. chapitre Théorie Des Ensembles).
ce qui est bien seulement un sous-ensemble associé de E mais de même cardinal (cf. chapitre Théorie Des Ensembles).
Définition: Soit P une propriété sur l'ensemble E. Une propriété Q sur E est une "négation" de P si et seulement si, pour tout ![]() :
:
- ![]() est F si P(x) est V
est F si P(x) est V
- ![]() est V si P(x) est F
est V si P(x) est F
Nous pouvons rassembler ces conditions dans une table dite "table de vérité" :
|
P |
Q |
|
V |
F |
|
F |
V |
En d'autres termes, P et Q ont toujours des valeurs de vérité contraires. Nous noterons ce genre d'énoncé "Q est une négation de P" :
![]() (1.3)
(1.3)
où le symbole ![]() est le "connecteur de négation".
est le "connecteur de négation".
CONNECTEURS
Il y a d'autres types de connecteurs en logique :
Soit P et Q deux propriétés définies sur le même ensemble E. ![]() (lire "P ou Q") est une propriété sur E définie par :
(lire "P ou Q") est une propriété sur E définie par :
- ![]() est vraie si au moins l'une des propriétés P, Q est vraie
est vraie si au moins l'une des propriétés P, Q est vraie
- ![]() est fausse sinon
est fausse sinon
Nous pouvons créer la table de vérité du "connecteur OU" ou "connecteur de disjonction" ![]() :
:
|
P |
Q |
|
|
V |
V |
V |
|
V |
F |
V |
|
F |
V |
V |
|
F |
F |
F |
Il est facile de se convaincre que, si les parties P, Q de E sont respectivement associées aux propriétés P, Q que ![]() (cf. chapitre Théorie Des Ensembles) est associé à
(cf. chapitre Théorie Des Ensembles) est associé à ![]() .
.
 (1.4)
(1.4)
Le connecteur ![]() est associatif. Pour s'en convaincre, il suffit de faire une table vérité où nous vérifions que :
est associatif. Pour s'en convaincre, il suffit de faire une table vérité où nous vérifions que :
![]() (1.5)
(1.5)
Il existe également le "connecteur ET" ou "connecteur de conjonction" ![]() pour quel que soientP, Q deux propriétés définies sur E,
pour quel que soientP, Q deux propriétés définies sur E, ![]() est une propriété sur E définie par :
est une propriété sur E définie par :
- ![]() est vraie si toutes les deux propriétés P, Q sont vraies
est vraie si toutes les deux propriétés P, Q sont vraies
- ![]() est fausse sinon
est fausse sinon
Nous pouvons créer la table de vérité du connecteur ![]() :
:
|
P |
Q |
|
|
V |
V |
V |
|
V |
F |
F |
|
F |
V |
F |
|
F |
F |
F |
Il est également facile de se convaincre que, si les parties P, Q de E sont respectivement associées aux propriétés P, Q que ![]() (cf. chapitre Théorie Des Ensembles) est associé à
(cf. chapitre Théorie Des Ensembles) est associé à ![]() :
:
 (1.6)
(1.6)
Le connecteur ![]() est associatif. Pour s'en convaincre, il suffit aussi de faire une table vérité où nous vérifions que:
est associatif. Pour s'en convaincre, il suffit aussi de faire une table vérité où nous vérifions que:
![]() (1.7)
(1.7)
Les connecteurs ![]() sont distributifs l'un sur l'autre. A l'aide d'une simple table de vérité, nous prouvons que:
sont distributifs l'un sur l'autre. A l'aide d'une simple table de vérité, nous prouvons que:
![]() (1.8)
(1.8)
ainsi que:
![]() (1.9)
(1.9)
Une négation de ![]() est
est ![]() une négation de
une négation de ![]() est
est ![]() tel que pour résumer:
tel que pour résumer:
![]() (1.10)
(1.10)
A nouveau, ces propriétés peuvent se démontrer par une simple table de vérité.
Revenons maintenant sur le "connecteur d'implication logique" appelé aussi parfois le "conditionnel" noté "![]() "
"
Soient P, Q deux propriétés sur E. ![]() est une propriété sur E définie par:
est une propriété sur E définie par:
- ![]() est fausse si P est vraie et Q fausse
est fausse si P est vraie et Q fausse
- ![]() est vraie sinon
est vraie sinon
En d'autres termes, P implique logiquement Q signifie que Q est vrai pour toute évaluation pour laquelle P est vraie. L'implication représente donc le "si... alors.."
Si nous écrivons la table de vérité de l'implication (attention à l'avant dernière ligne !!!) :
Si ![]() , nous pouvons dire que pour que Q soit vraie, il suffit que P soit vraie (effectivement l'implication sera vraie si P est vraie ou fausse selon la table de vérité). Donc P est une condition suffisante de Q (mais non nécessaire!). D'un autre côté,
, nous pouvons dire que pour que Q soit vraie, il suffit que P soit vraie (effectivement l'implication sera vraie si P est vraie ou fausse selon la table de vérité). Donc P est une condition suffisante de Q (mais non nécessaire!). D'un autre côté, ![]() est équivalent à
est équivalent à ![]() . Donc, si Q est fausse, il est impossible que P soit vraie (pour que l'implication reste vraie bien sûr!). Donc finalement Q est une condition nécessaire de P.
. Donc, si Q est fausse, il est impossible que P soit vraie (pour que l'implication reste vraie bien sûr!). Donc finalement Q est une condition nécessaire de P.
![]() Exemples:
Exemples:
E1. Soit la proposition : "Si tu obtiens ton diplôme, je t'achète un ordinateur"
Parmi tous les cas, un seul correspond à une promesse non tenue: celui où l'enfant à son diplôme, et n'a toujours pas d'ordinateur (deuxième ligne dans le tableau).
Et le cas où il n'a pas le diplôme, mais reçoit quand même un ordinateur? Il est possible qu'il ait été longtemps malade et a raté un semestre, et le père a le droit d'être bon.
Que signifie cette promesse, que nous écrirons aussi : "Tu as ton diplôme ![]() je t'achète un ordinateur" ? Exactement ceci:
je t'achète un ordinateur" ? Exactement ceci:
- Si tu as ton diplôme, c'est sûr, je t'achète un ordinateur (je ne peux pas ne pas l'acheter)
- Si tu n'as pas ton diplôme, je n'ai rien dit
E2. De toute proposition fausse nous pouvons déduire toute proposition (deux dernières lignes)
C'est un exemple plutôt anecdotique : dans un cours de Russell portant sur le fait que d'une proposition fausse, toute proposition peut être déduite, un étudiant lui posa la question suivante :
- "Prétendez-vous que de 2 + 2 = 5, il s'ensuit que vous êtes le pape ? "
- "Oui", fit Russell
- "Et pourriez-vous le prouver !", demanda l'étudiant sceptique
- "Certainement", réplique Russell, qui proposa sur le champ la démonstration suivante.
(1) Supposons que 2 + 2 = 5
(2) Soustrayons 2 de chaque membre de l'égalité, nous obtenons 2 = 3
(3) Par symétrie, 3 = 2
(4) Soustrayant 1 de chaque côté, il vient 2 =1
Maintenant le pape et moi sommes deux. Puisque 2 = 1, le pape et moi sommes un. Par suite, je suis le pape.
Sur ce ...
Le connecteur d'implication est essentiel en mathématiques, philosophie, etc. C'est un des fondements de toute démonstration, preuve ou déduction.
Le connecteur d'implication a comme propriétés (vérifiables à l'aide de la table de vérité ci-dessous) :
![]() (1.11)
(1.11)
conséquence de la dernière propriété (à nouveau vérifiable par une table de vérité) :
![]() (1.12)
(1.12)
Le "connecteur d'équivalence logique" ou "bi-conditionnel" noté "![]() " ou "
" ou "![]() " signifiant par définition que :
" signifiant par définition que :
![]() (1.13)
(1.13)
en d'autres termes, la première expression a la même valeur pour toute évaluation de la deuxième.
Ce que nous pouvons vérifier à l'aide d'une table de vérité:
|
P |
Q |
|
|
V |
V |
V |
|
V |
F |
F |
|
F |
V |
V |
|
F |
F |
V |
|
P |
Q |
|
|
|
|
V |
V |
V |
V |
V |
|
V |
F |
F |
V |
F |
|
F |
V |
V |
F |
F |
|
F |
F |
V |
V |
V |
![]() signifie bien (lorsqu'il est vrai!) que "P et Q ont toujours la même valeur de vérité" ou encore "P et Q sont équivalents". C'est vrai si P et Q ont même valeur, faux dans tout cas contraire.
signifie bien (lorsqu'il est vrai!) que "P et Q ont toujours la même valeur de vérité" ou encore "P et Q sont équivalents". C'est vrai si P et Q ont même valeur, faux dans tout cas contraire.
Bien évidemment (c'est une tautologie) :
![]() (1.14)
(1.14)
La relation ![]() équivaut donc à ce que P soit une condition nécessaire et suffisante de Q et à ce que Q soit une condition nécessaire et suffisante de P.
équivaut donc à ce que P soit une condition nécessaire et suffisante de Q et à ce que Q soit une condition nécessaire et suffisante de P.
La conclusion, est que les conditions de type "nécessaire, suffisant, nécessaire et suffisant" peuvent être reformulés avec les termes "seulement si", "si", "si et seulement si".
Ainsi :
1. ![]() traduit le fait que Q est une condition nécessaire pour P ou dit autrement, P est vraieseulement si Q est vraie (dans le table de vérité, lorsque
traduit le fait que Q est une condition nécessaire pour P ou dit autrement, P est vraieseulement si Q est vraie (dans le table de vérité, lorsque ![]() prend la valeur 1 on constate bien que P vaut 1 seulement si Q vaut 1 aussi). On dit aussi, si P est vraie alors Q est vraie.
prend la valeur 1 on constate bien que P vaut 1 seulement si Q vaut 1 aussi). On dit aussi, si P est vraie alors Q est vraie.
2. ![]() ou ce qui reviens au même
ou ce qui reviens au même ![]() traduit le fait que Q est une condition suffisante pourP ou dit autrement, P est vraie si Q est vraie (dans le table de vérité, lorsque
traduit le fait que Q est une condition suffisante pourP ou dit autrement, P est vraie si Q est vraie (dans le table de vérité, lorsque ![]() prend la valeur 1 on constate bien que P vaut 1 si Q vaut 1 aussi).
prend la valeur 1 on constate bien que P vaut 1 si Q vaut 1 aussi).
3. ![]() traduit le fait que Q est une condition nécessaire et suffisante pour P ou dit autrement, Pest vraie si et seulement si Q est vraie (dans le table de vérité, lorsque
traduit le fait que Q est une condition nécessaire et suffisante pour P ou dit autrement, Pest vraie si et seulement si Q est vraie (dans le table de vérité, lorsque ![]() prend la valeur 1 on constate bien que P vaut 1 si Q vaut 1 et seulement si Q vaut 1).
prend la valeur 1 on constate bien que P vaut 1 si Q vaut 1 et seulement si Q vaut 1).
La première étape du calcul propositionnel est donc la formalisation des énoncés du langage naturel. Pour réaliser ce travail, le calcul propositionnel fournit finalement trois types d'outils :
1. Les "variables propositionnelles" (P, Q, R,...) symbolisent des propositions simples quelconques. Si la même variable apparaît plusieurs fois, elle symbolise chaque fois la même proposition.
2. Les cinq opérateurs logiques : ![]()
3. Les signes de ponctuation se réduisent aux seules parenthèses ouvrante et fermante qui organisent la lecture de manière à éviter toute ambiguïté.
Voici un tableau récapitulatif :
|
Description |
Symbole |
Utilisation |
|
La "négation" est un opérateur qui ne porte que sur une proposition, il est unaire ou monadique. "Il ne pleut pas" s'écrit |
|
|
|
La "conjonction" ou "produit logique" est un opérateur binaire, elle met en relation deux propositions. "Tout homme est mortel ET Ma voiture perd de l'huile" s'écrit |
|
|
|
La "disjonction" ou "somme logique" est, elle aussi, un opérateur binaire. |
|
|
|
"L'implication" est également un opérateur binaire. Elle correspond, en gros, au schéma linguistique "Si...alors...". "Si j'ai le temps, j'irai au cinéma" s'écrit |
|
|
|
La "bi-implication" est, elle aussi, binaire : elle symbolise les expressions "... si et seulement si..." et "... est équivalent à..." L'équivalence entre deux propositions est vraie si celles-ci ont la même valeur de vérité. La bi-implication exprime donc aussi une forme d'identité et c'est pourquoi elle est souvent utilisée dans les définitions. |
|
|
Tableau: 1.6 - Récapitulatif des opérateurs
Il est possible d'établir des équivalences entre ces opérateurs. Nous avons déjà vu comment le bi-conditionnel pouvait se définir comme un produit de conditionnels réciproques, voyons maintenant d'autres équivalences :
 (1.15)
(1.15)
Sont à noter également les deux relations de De Morgan (cf. chapitre d'Algèbre de Boole) :
 (1.16)
(1.16)
Elles permettent de transformer la disjonction en conjonction et vice-versa :
 (1.17)
(1.17)
PROCÉDURES DE DÉCISION
Nous avons introduit précédemment les éléments de base nous permettant d'opérer sur des expressions à partir de propriétés (variables propositionnelles) sans toutefois dire grand chose quant à la manipulation de ces expressions. Alors, il convient maintenant de savoir qu'en calcul propositionel qu'il existe deux manières d'établir qu'une proposition est un loi de la logique propositionnelle. Nous pouvons soit :
1. Employer des procédures non axiomatisées
2. Recourir à des procédures axiomatiques et démonstratives
PROCÉDURES DE DÉCISIONS NON AXIOMATISÉES
Plusieurs de ces méthodes existent mais nous nous limiterons ici à la plus simple et à la plus parlante d'entre elles, celle du calcul matriciel, souvent appelée aussi "méthodes des tables de vérité".
La procédure de construction est comme nous l'avons vu précédemment assez simple. Effectivement, la valeur de vérité d'une expression complexe est fonction de la valeur vérité des énoncés plus simples qui la composent, et finalement fonction de la valeur de vérité des variables propositionelles qui la composent. En envisageant toutes les combinaisons possibles des valeurs de vérité des variables de propositionnelles, nous pouvons déterminer les valeurs de vérité de l'expression complexe.
Les tables de vérité, comme nous l'avons vu, permettent donc de décider, à propos de toute proposition, si celle-ci est une tautologie (toujours vraie), une contradiction (toujours fausse) ou une expression contingente (parfois vraie, parfois fausse).
Nous pouvons ainsi distinguer quatre façons de combiner les variables propositionnelles, les paranthèses et les connecteurs :
La méthode des tables de vérité permet de déterminer le type d'expression bien formée face auquel nous nous trouvons. Elle n'exige en principe aucune invention, c'est une procédure mécanique. Les procédures axiomatisées, en revanche, ne sont pas entièrement mécaniques. Inventer une démonstration dans le cadre d'un système axiomatisé demande parfois de l'habilité, de l'habitude ou de la chance. Pour ce qui est des tables de vérité, voici la marche à suivre :
Lorsqu'on se trouve face à un expression bien formée, ou fonction de vérité, nous commencons par déterminer à combien de variables propositionnelles distinctes nous avons affaire. Ensuite, nous examinons les différents arguments qui constituent cette expression. Nous construisons alors un tableau comprenant ![]() rangées (n étant le nombre de variables) et un nombre de colonnes égal au nombre d'arguments plus des colonnes pour l'expression elle-même et ses autres composantes. Nous attribuons alors aux variables les différentes combinaisons de vérité et de fausseté qui peuvent leur être conférées (la vérité est exprimée dans la table par un 1 et la fausseté par un 0). Chacune des rangées correspond à un monde possible et la totalité des rangées constitue l'ensemble des mondes possibles. Il existe, par exemple, un monde possible dans lequel P est une proposition vraie tandis que Q est fausse.
rangées (n étant le nombre de variables) et un nombre de colonnes égal au nombre d'arguments plus des colonnes pour l'expression elle-même et ses autres composantes. Nous attribuons alors aux variables les différentes combinaisons de vérité et de fausseté qui peuvent leur être conférées (la vérité est exprimée dans la table par un 1 et la fausseté par un 0). Chacune des rangées correspond à un monde possible et la totalité des rangées constitue l'ensemble des mondes possibles. Il existe, par exemple, un monde possible dans lequel P est une proposition vraie tandis que Q est fausse.
PROCÉDURES DE DÉCISIONS AXIOMATISÉES
L'axiomatisation d'une théorie implique, outre la formalisation de celle-ci, que nous partions d'un nombre fini d'axiomes et que, grâce à la transformation réglée de ces derniers, que nous puissions obtenir tous les théorèmes de cette théorie. Nous pardons donc de quelques axiomes dont la vérité est posée (et non démontrée). Nous déterminons des règles de déduction permettant de manipuler les axiomes ou toute expression obtenue à partir de ceux-ci. L'enchaînement de ces déductions est une démonstration qui conduit à un théorème, à une loi.
Nous allons sommairement présenter deux systèmes axiomatiques, chacun étant constitué d'axiomes utilisant deux règles dites "règles d'inférence" (règles intuitives) particulières :
1. Le "modus ponens" : si nous avons prouvé A et ![]() , alors nous pouvons déduire B. A est appelé la "prémisse mineure" et
, alors nous pouvons déduire B. A est appelé la "prémisse mineure" et ![]() la prémisse majeure de la règle du modus ponens.
la prémisse majeure de la règle du modus ponens.
![]() Exemple:
Exemple:
De ![]() et
et ![]() nous pouvons déduire
nous pouvons déduire ![]()
2. La "substitution" : nous pouvons dans un schéma d'axiome remplacer une lettre par une formule quelconque, pourvue que toutes les lettres identiques soient remplacées par des formules identiques.
Donnons à titre d'exemple, deux systèmes axiomatiques : le système axiomatique de Whithead et Rusell, le système axiomatique de Lukasiewicz.
1. Le système axiomatique de Whitehead et Russel adopte comme symboles primitifs ![]() et définit
et définit![]() à partir de ces derniers de la manière suivante (relations facilement vérifiables à l'aide de tables de vérité) :
à partir de ces derniers de la manière suivante (relations facilement vérifiables à l'aide de tables de vérité) :
 (1.18)
(1.18)
nous avions déjà présenté plus haut quelque uns de ces éléments.
Ce système comprend cinq axiomes, assez évidents en soi plus les deux règles d'inférence. Les axiomes sont donnés ici en utilisant des symboles non primitifs, comme le faisaient Whitehead et Russel :
A1. ![]()
A2. ![]()
A3. ![]()
A4. ![]()
A5. ![]()
![]() Exemple:
Exemple:
Pour prouver ![]() , nous pouvons procéder ainsi :
, nous pouvons procéder ainsi :

(1.19)
2. Le système axiomatique Lukasiewicz comprend les trois axiomes suivants, plus les deux règles d'inférences (modus ponens et substitution):
A1. ![]()
A2. ![]()
A3. ![]()
Voici des preuves des deux premiers axiomes, dans le système de Whitehead et Russel. Ce sont les formules (6) et (16) de la dérivation suivante :

(1.20)
Ces axiomatisations permettent de retrouver comme théorème toutes les tautologies ou lois de la logique propositionnelle. De par tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant, nous pouvons tenter de définir ce qu'est une preuve.
Définition: Une suite finie de formules ![]() est appelée "preuve" à partir des hypothèses
est appelée "preuve" à partir des hypothèses ![]() si pour chaque i :
si pour chaque i :
- ![]() est l'une des hypothèses
est l'une des hypothèses ![]()
- ou ![]() est une variante d'un axiome
est une variante d'un axiome
- ou ![]() est inférée (par application de la règle du modus ponens) à partir de la prémisse majeure
est inférée (par application de la règle du modus ponens) à partir de la prémisse majeure ![]() et de la prémisse mineure
et de la prémisse mineure ![]() où
où ![]()
- ou ![]() est inférée (par application de la règle de substitution) à partir d'une prémisse antérieure
est inférée (par application de la règle de substitution) à partir d'une prémisse antérieure ![]() , la variable remplacée n'apparaissant pas dans
, la variable remplacée n'apparaissant pas dans ![]()
Une telle suite de formules, ![]() étant la formule finale de la suite, est appelée plus explicitement "preuve de
étant la formule finale de la suite, est appelée plus explicitement "preuve de ![]() " à partir des hypothèses
" à partir des hypothèses ![]() , ce que nous notons par :
, ce que nous notons par :
![]() (1.21)
(1.21)
QUANTIFICATEURS
Nous devons compléter l'utilisation des connecteurs du calcul propositionnel par ce que nous appelons des "quantificateurs" si nous souhaitons pouvoir résoudre certains problèmes. Effectivement, le calcul propositionnel ne nous permet pas d'affirmer des choses générales sur les éléments d'un ensemble par exemple. Dans ce sens, la logique propositionnelle ne reflète qu'une partie du raisonnement. Le "calcul des prédicats" au contraire permet de manipuler formellement des affirmations telles que "il existe un x tel que [x a une voiture américaine]" ou "pour tous les x [si x est une teckel, alors x est petit]"; en somme, nous étendons les formules composées afin de pouvoir affirmer des quantifications existentielles ("il existe...") et des quantifications universelles ("pour tout...."). Les exemples que nous venons de donner font intervenir des propositions un peu particulières comme "x a une voiture américaine". Il s'agit ici de propositions comportant une variable. Ces propositions sont en fait l'application d'une fonction à x. Cette fonction, c'est celle qui associe "x a une voiture américaine" à x. Nous dénoterons cette fonction par "... a une voiture américaine" et nous dirons que c'est une fonction propositionnelle, car c'est une fonction dont la valeur est une proposition. Ou encore un "prédicat".
Les quantificateurs existentiels et universels vont donc de pair avec l'emploi de fonctions propositionnelles. Le calcul des prédicats est cependant limité dans les formules existentielles et universelles. Ainsi, nous nous interdisons des formules comme "il existe une affirmation de x telle que...". En fait, nous ne nous autorisons à quantifier que des "individus". C'est pour cela que la logique des prédicats est dite une "logique de premier ordre".
Avant de passer à l'étude du calcul des prédicats nous devons définir :
D1. Le "quantificateur universel" : ![]() (pour tout)
(pour tout)
D2. Le "quantificateur existentiel" : ![]() (il existe)
(il existe)
![]() (1.22)
(1.22)
Nous allons voir que la théorie de la démonstration et des ensembles est l'exacte transcription des principes et résultats de la Logique (celle avec un "L" majuscule).
CALCUL DES PRÉDICATS
Dans un cours de mathématiques (d'algèbre, d'analyse, de géométrie, ...), nous démontrons les propriétés de différents types d'objets (entiers, réels, matrices, suites, fonctions continues, courbes, ...). Pour pouvoir prouver ces propriétés, il faut bien sûr que les objets sur lesquels nous travaillons soient clairement définis (qu'est-ce qu'un entier, un réel, ...?).
En logique du premier ordre et, en particulier, en théorie de la démonstration, les objets que nous étudions sont les formules et leurs démonstrations. Il faut donc donner une définition précise de ce que sont ces notions. Les termes et les formules forment la grammaire d'une langue, simplifiée à l'extrême et calculée exactement pour dire ce que nous voulons sans ambiguïté et sans détour inutile.
GRAMMAIRE
Définitions:
D1. Les "termes", désignent les objets dont nous voulons prouver des propriétés (nous reviendrons un peu plus loin beaucoup plus en détail sur ces derniers) :
- En algèbre, les termes désignent les éléments d'un groupe (ou anneau, corps, espace vectoriel, etc.). Nous manipulons aussi des ensembles d'objets (sous-groupe, sous-espace vectoriel, etc). Les termes qui désignent ces objets, d'un autre type, seront appelés "termes du second ordre".
- En analyse, les termes désignent les réels ou (par exemple, si nous nous plaçons dans des espaces fonctionnels) des fonctions.
D2. Les "formules", représentent les propriétés des objets que nous étudions (nous reviendrons également beaucoup plus en détail sur ces dernières) :
- En algèbre, nous pourrons écrire des formules pour exprimer que deux éléments commutent, qu'un sous-espace vectoriel est de dimension 3, etc.
- En analyse, nous écrirons des formules pour exprimer la continuité d'une fonction, la convergence d'une suite, etc.
- En théorie des ensembles, les formules pourront exprimer l'inclusion de deux ensembles, l'appartenance d'un élément à un ensemble,...
D3. Les "démonstrations", elles permettent d'établir qu'une formule est vraie. Le sens précis de ce mot aura lui aussi besoin d'être défini. Plus exactement, elles sont des déductions sous hypothèses, elles permettent de "mener du vrai au vrai", la question de la vérité de la conclusion étant alors renvoyée à celle des hypothèses, laquelle ne regarde pas la logique mais repose sur la connaissance que nous avons des choses dont nous parlons.
LANGAGES
En mathématique, nous utilisons, suivant le domaine, différents langages qui se distinguent par les symboles utilisés. La définition ci-dessous exprime simplement qu'il suffit de donner la liste de ces symboles pour préciser le langage.
Définition: Un "langage" est la donnée d'une famille (pas nécessairement finie) de symboles. Nous en distinguons trois sortes : symboles, termes et formules.
R1. Nous utilisons quelques fois le mot "vocabulaire" ou le mot "signature" à la place du mot "langage".
R2. Le mot "prédicat" peut être utilisé à la place du mot "relation". Nous parlons alors de "calcul des prédicats" au lieu de "logique du premier ordre" (ce que nous avons étudié précédemment).
SYMBOLES
Il existe différents types de symboles que nous allons tâcher de définir :
D1. Les "symboles de constante" (voir remarque plus bas)
![]() Exemple:
Exemple:
Le n pour l'élément neutre en théorie des ensembles (cf. chapitre de Théorie Des Ensembles)
D2. Les "symboles de fonction" ou "foncteurs" . A chaque symbole de fonction est associé un entier strictement positif que nous appelons son "arité" : c'est le nombre d'arguments de la fonction. Si l'arité est 1 (resp. 2, ...,n), nous disons que la fonction est unaire (resp. binaire, ..., n-aire)
![]() Exemple:
Exemple:
Le foncteur binaire de multiplication * dans les groupes (cf. chapitre de Théorie Des Ensembles).
D3. Les "symboles de relation". De la même manière, à chaque symbole de relation est associé un entier positif ou nul (son arité) qui correspond à son nombre d'arguments et nous parlons de relation unaire, binaire, n-aire (comme par exemple le symbole de relation "=").
D4. Les "variables individuelles". Dans toute la suite, nous nous donnerons un ensemble infini V de variables. Les variables seront notées comme il l'est par tradition : x, y, z (éventuellement indexées: ![]() ).
).
D5. A cela il faut rajouter les connecteurs et quantificateurs que nous avons longuement présenté plus haut et sur lesquels il est pour l'instant inutile de revenir.
R1. Un symbole de constante peut être vu comme un symbole de fonction à 0 argument (d'arité nulle).
R2. Nous considèrons (sauf mention contraire) que chaque langage contient le symbole de relation binaire = (lire "égal") et le symbole de relation à zéro argument dénoté ![]() (lire "bottom" ou "absurde") qui représente le faux. Dans la description d'un langage, nous omettrons donc souvent de les mentionner. Le symbole
(lire "bottom" ou "absurde") qui représente le faux. Dans la description d'un langage, nous omettrons donc souvent de les mentionner. Le symbole ![]() est souvent redondant. Nous pouvons en effet, sans l'utiliser, écrire une formule qui est toujours fausse. Il permet cependant de représenter le faux d'une manière canonique et donc d'écrire des règles de démonstration générales.
est souvent redondant. Nous pouvons en effet, sans l'utiliser, écrire une formule qui est toujours fausse. Il permet cependant de représenter le faux d'une manière canonique et donc d'écrire des règles de démonstration générales.
R3. Le rôle des fonctions et des relations est très différent. Comme nous le verrons plus loin, les symboles de fonction sont utilisés pour construire les termes (les objets du langage) et les symboles de relation pour construire les formules (les propriétés de ces objets).
TERMES
Les termes (nous disons aussi "termes du premier ordre") représentent les objets associés au langage.
Définitions:
Soit ![]() un langage :
un langage :
D1. L'ensemble ![]() des termes sur
des termes sur ![]() est le plus petit ensemble contenant les variables, les constantes et stable (on ne sort pas de l'ensemble) par l'application des symboles de fonction de
est le plus petit ensemble contenant les variables, les constantes et stable (on ne sort pas de l'ensemble) par l'application des symboles de fonction de![]() à des termes.
à des termes.
D2. Un "terme clos" est un terme qui ne contient pas de variables (donc par extension, seulement des constantes).
D3. Pour obtenir une définition plus formelle, nous pouvons écrire :
![]() (1.23)
(1.23)
où t est une variable ou un symbole de constante et, pour tout ![]() :
:
![]() (1.24)
(1.24)
où f est une fonction d'arité n (rappelons que l'arité est le nombre d'arguments de la fonction). Ainsi, pour chaque arité, il y a un degré d'ensemble de termes. Nous avons finalement :
![]() (1.25)
(1.25)
D4. Nous appellerons "hauteur" d'un terme t le plus petit k tel que ![]()
Remarques :
R1. la définition D4 signifie que les variables et les constantes sont des termes et que si f est un symbole de fonction n-aire et ![]() sont des termes alors
sont des termes alors ![]() est un terme en soi aussi. L'ensemble
est un terme en soi aussi. L'ensemble ![]() des termes est défini par la grammaire:
des termes est défini par la grammaire:
![]() (1.26)
(1.26)
Cette expression se lit de la manière suivante : un élément de l'ensemble ![]() que nous sommes en train de définir est soit un élément de V (variables), soit un élément de
que nous sommes en train de définir est soit un élément de V (variables), soit un élément de ![]() (l'ensemble des symboles de constantes), soit l'application d'un symbole de fonction
(l'ensemble des symboles de constantes), soit l'application d'un symbole de fonction ![]() à n éléments (constantes ou variables) de
à n éléments (constantes ou variables) de ![]() .
.
Attention : le fait que f soit de la bonne arité est seulement implicite dans cette notation. De plus, l'écriture ![]() ne signifie pas que tous les arguments d'une fonction sont identiques mais simplement que ces arguments sont des éléments de
ne signifie pas que tous les arguments d'une fonction sont identiques mais simplement que ces arguments sont des éléments de ![]() .
.
R2. Il est souvent commode de voir un terme (expression) comme un arbre dont chaque noeud est étiqueté par un symbole de fonction (opérateur ou fonction) et chaque feuille par une variable ou une constante.
Dans la suite, nous allons sans cesse définir des notions (ou prouver des résultats) "par récurrence" sur la structure ou la taille d'un terme.
Définitions:
D1. Pour prouver une propriété P sur les termes, il suffit de prouver P pour les variables et les constantes et de prouver ![]() à partir de
à partir de ![]() . Nous faisons ainsi ici une "preuve par induction sur la "hauteur"" d'un terme. C'est une technique que nous retrouverons dans les chapitres suivants.
. Nous faisons ainsi ici une "preuve par induction sur la "hauteur"" d'un terme. C'est une technique que nous retrouverons dans les chapitres suivants.
D2. Pour définir une fonction ![]() sur les termes, il suffit de la définir sur les variables et les constantes et de dire comment nous obtenons
sur les termes, il suffit de la définir sur les variables et les constantes et de dire comment nous obtenons ![]() à partir de
à partir de ![]() . Nous faisons ici encore une "définition par induction sur la hauteur d'un terme".
. Nous faisons ici encore une "définition par induction sur la hauteur d'un terme".
![]() Exemple:
Exemple:
La taille (nous disons aussi la "longueur") d'un terme t (notée ![]() ) est le nombre de symboles de fonction apparaissant dans t. Formellement:
) est le nombre de symboles de fonction apparaissant dans t. Formellement:
- ![]() si x est une variable et c est une constante
si x est une variable et c est une constante
- ![]()
FORMULES
Les formules sont construites à partir de "formules atomiques" en utilisant des connecteurs et des quantificateurs. Nous utiliserons les connecteurs et les quantificateurs suivants (qui nous sont déjà connus) :
- connecteur unaire de négation : ![]()
- connecteurs binaires de conjonction et disjonction ainsi que d'implication : ![]() ,
, ![]() ,
, ![]()
- quantificateurs : ![]() qui se lit "il existe" et
qui se lit "il existe" et ![]() qui se lit "pour tout"
qui se lit "pour tout"
Cette notation des connecteurs est standard (elle devrait du moins). Elle est utilisée pour éviter les confusions entre les formules et le langage courant (le métalangage).
Définitions:
D1. Soit ![]() un langage, les "formules atomiques" de
un langage, les "formules atomiques" de ![]() sont les formules de la forme
sont les formules de la forme ![]() oùR est un symbole de relation n-aire de
oùR est un symbole de relation n-aire de ![]() et
et ![]() sont des termes de
sont des termes de ![]() . Nous notons "Atom" l'ensemble des formules atomiques. Si nous notons
. Nous notons "Atom" l'ensemble des formules atomiques. Si nous notons ![]() l'ensemble des symboles de relation, nous pouvons écrire l'ensemble des termes mis en relations par l'expression :
l'ensemble des symboles de relation, nous pouvons écrire l'ensemble des termes mis en relations par l'expression :
![]() (1.27)
(1.27)
L'ensemble F des formules de la logique du premier ordre de ![]() est donc défini par la grammaire (où x est une variable) :
est donc défini par la grammaire (où x est une variable) :
![]() (1.28)
(1.28)
où il faut lire : l'ensemble des formules est le plus petit ensemble contenant les formules et tel que si ![]() et
et ![]() sont des formules alors
sont des formules alors ![]() , etc. sont des formules et qu'elles peuvent être en relation entre elles.
, etc. sont des formules et qu'elles peuvent être en relation entre elles.
![]() Exemple:
Exemple:
Les symboles de relation du langage propositionnel sont des relations d'arité 0 (même le symbole "=" est absent), les quantificateurs sont alors inutiles (puisqu'une formule propositionnelle ne peut pas contenir des variables). Nous obtenons alors le calcul propositionnel défini par :
![]() (1.29)
(1.29)
Remarquons la présence du symbole "botton" signifiant le "faux" que nous n'avions pas mentionné lors de notre étude de la logique propositionnelle.
Nous ferons attention à ne pas confondre termes et formules. ![]() est un terme (fonction),
est un terme (fonction), ![]() est une formule. Mais
est une formule. Mais ![]() n'est rien : nous ne pouvons, en effet, mettre un connecteur entre un terme et une formule (aucun sens).
n'est rien : nous ne pouvons, en effet, mettre un connecteur entre un terme et une formule (aucun sens).
R1. Pour définir une fonction ![]() sur les formules, il suffit de définir
sur les formules, il suffit de définir ![]() sur les formules atomiques.
sur les formules atomiques.
R2. Pour prouver une propriété P sur les formules, il suffit de prouver P pour les formules atomiques.
R3. Pour prouver une propriété P sur les formules, il suffit de supposer la propriété vraie pour toutes les formules de taille ![]() et de la démontrer pour les formules de taille n.
et de la démontrer pour les formules de taille n.
D2. Une "sous-formule" d'une formule (ou expression) F est l'un de ses composants, in extenso une formule à partir de laquelle F est construite. Formellement, nous définissons l'ensemble SF(F) des sous-formules F par:
- Si F est atomique:![]()
- Si ![]() (soit une composition!) avec
(soit une composition!) avec![]()
- Si ![]() ou
ou ![]() avec
avec ![]()
D3. Une formule F de ![]() n'utilise qu'un nombre fini de symboles de
n'utilise qu'un nombre fini de symboles de ![]() . Ce sous-ensemble est appelé le "langage de la formule" et noté
. Ce sous-ensemble est appelé le "langage de la formule" et noté ![]() .
.
D4. La "taille (ou la longueur) d'une formule" F (notée ![]() ) est le nombre de connecteurs ou de quantificateurs apparaissant dans F. Formellement :
) est le nombre de connecteurs ou de quantificateurs apparaissant dans F. Formellement :
- ![]() si F est une formule atomique
si F est une formule atomique
- ![]() où
où ![]()
- ![]() avec
avec ![]()
D5. "L'opérateur principal" (nous disons aussi le "connecteur principal") d'une formule est défini par :
- Si A est atomique, alors elle n'a pas d'opérateur principal
- Si ![]() , alors
, alors ![]() est l'opérateur principal de A
est l'opérateur principal de A
- Si ![]() où
où ![]() , alors
, alors ![]() est l'opérateur principal de A
est l'opérateur principal de A
- Si ![]() où
où ![]() , alors
, alors ![]() est l'opérateur principal de A
est l'opérateur principal de A
D6. Soit F une formule. L'ensemble ![]() des variables libres de F et l'ensemble
des variables libres de F et l'ensemble ![]() des variables muettes (ou liées) de F sont définis par récurrence sur
des variables muettes (ou liées) de F sont définis par récurrence sur ![]() .
.
Une occurrence d'une variable donnée est dite "variable liée" ou "variable muette" dans une formuleF si dans cette même formule, un quantificateur y fait référence. Dans le cas contraire, nous disons avoir une "variable libre".
Pour préciser les variables libres possibles d'une formule F, nous noterons ![]() . Cela signifie que les variables libres de F sont parmi
. Cela signifie que les variables libres de F sont parmi ![]() in extenso si y est libre dans F, alors y est l'un des
in extenso si y est libre dans F, alors y est l'un des ![]() mais les
mais les ![]() n'apparaissent pas nécessairement dans F.
n'apparaissent pas nécessairement dans F.
Nous pouvons définir les variables muettes ou libre de manière plus formelle :
1. Si ![]() est atomique alors
est atomique alors ![]() est l'ensemble des variables libres apparaissant dans les
est l'ensemble des variables libres apparaissant dans les ![]() et nous avons alors pour les variables muettes
et nous avons alors pour les variables muettes ![]()
2. Si ![]() où
où ![]() :
: ![]() alors
alors![]()
3. si ![]() alors
alors ![]() et
et ![]()
4. si ![]() avec
avec ![]() et
et ![]()
![]() Exemples:
Exemples:
E1. Soit F : ![]() alors
alors ![]() et
et ![]()
E2. Soit G : ![]() alors
alors ![]() et
et ![]()
D7. Nous disons que les formules F et G sont "![]() -équivalentes" si elles sont (syntaxiquement) identiques à un renommage près des occurrences liées des variables.
-équivalentes" si elles sont (syntaxiquement) identiques à un renommage près des occurrences liées des variables.
D8. Une "formule close" est une formule sans variables libres.
D9. Soit F une formule, x une variable et t un terme. ![]() est la formule obtenue en remplaçant dans F toutes les occurrences libres de x par t, après renommage éventuel des occurrences liées deF qui apparaissent libres dans t.
est la formule obtenue en remplaçant dans F toutes les occurrences libres de x par t, après renommage éventuel des occurrences liées deF qui apparaissent libres dans t.
R1. Nous noterons dans les exemples vus qu'une variable peut avoir à la fois des occurrences libres et des occurrences liées. Nous n'avons donc pas toujours ![]()
R2. Nous ne pouvons pas renommer y en x dans la formule ![]() et obtenir la formule
et obtenir la formule ![]() : la variable x serait "capturée". Nous ne pouvons donc pas renommer des variables liées sans précautions : il faut éviter de capturer des occurrences libres.
: la variable x serait "capturée". Nous ne pouvons donc pas renommer des variables liées sans précautions : il faut éviter de capturer des occurrences libres.
DÉMONSTRATIONS
Les démonstrations que l'on trouve dans les ouvrages de mathématiques sont des assemblages de symboles mathématiques et de phrases contenant des mots clés tels que: "donc", "parce que", "si", "si et seulement si", "il est nécessaire que", "il suffit de", "prenons un x tel que", "supposons que", "cherchons une contradiction", etc. Ces mots sont supposés être compris par tous de la même manière, ce qui n'est en fait, pas toujours le cas.
Dans tout ouvrage, le but d'une démonstration est de convaincre le lecteur de la vérité de l'énoncé. Suivant le niveau du lecteur, cette démonstration sera plus ou moins détaillée : quelque chose qui pourra être considéré comme évident dans un cours de licence pourrait ne pas l'être dans un cours de niveau inférieur.
Dans un devoir, le correcteur sait que le résultat demandé à l'étudiant est vrai et il en connaît la démonstration. L'étudiant doit démontrer (correctement) le résultat demandé. Le niveau de détail qu'il doit donner dépend donc de la confiance qu'aura le correcteur : dans une bonne copie, une "preuve par une récurrence évidente" passera bien, alors que dans une copie où il y eu auparavant un "évident", qui était évidemment... faux, ça ne passera pas!
Pour pouvoir gérer convenablement le niveau de détail, il faut savoir ce qu'est une démonstration complète. Ce travail de formalisation a été fait qu'au début de 20ème siècle!!
Plusieurs choses peuvent paraître surprenantes:
- il n'y a qu'un nombre fini de règles: deux pour chacun des connecteurs (et l'égalité) plus trois règles générales. Il n'était pas du tout évident à piori qu'un nombre fini de règles soit suffisant pour démontrer tout ce qui est vrai. Nous montrerons ce résultat (c'est essentiellement, le théorème de complétude). La preuve n'en est pas du tout triviale.
- ce sont les mêmes règles pour toutes les mathématiques et la physique: algèbre, analyse, géométrie, etc. Cela veut dire que nous avons réussi à isoler tout ce qui est général dans un raisonnement. Nous verrons plus loin qu'une démonstration est un assemblage de couples, où ![]() est un ensemble de formules (les hypothèses) et A une formule (la conclusion). Quand nous faisons de l'arithmétique, de la géométrie ou de l'analyse réelle, nous utilisons, en plus des règles, des hypothèses que l'on appelle des "axiomes". Ceux-ci expriment les propriétés particulières des objets que nous manipulons (pour plus de détails sur les axiomes voir la page d'introduction du site).
est un ensemble de formules (les hypothèses) et A une formule (la conclusion). Quand nous faisons de l'arithmétique, de la géométrie ou de l'analyse réelle, nous utilisons, en plus des règles, des hypothèses que l'on appelle des "axiomes". Ceux-ci expriment les propriétés particulières des objets que nous manipulons (pour plus de détails sur les axiomes voir la page d'introduction du site).
Nous démontrons donc, en général, des formules en utilisant un ensemble d'hypothèses, et cet ensemble peut varier au cours de la démonstration: quand nous disons "supposons F et montronsG", F est alors une nouvelle hypothèse que nous pourrons utiliser pour montrer G. Pour formaliser cela, nous introduisons le concept de "séquent":
Définitions:
D1. Un "séquent" est un couple (noté ![]() ) où :
) où :
- ![]() est un ensemble fini de formules qui représente les hypothèses que nous pouvons utiliser. Cet ensemble s'appelle aussi le "contexte du séquent".
est un ensemble fini de formules qui représente les hypothèses que nous pouvons utiliser. Cet ensemble s'appelle aussi le "contexte du séquent".
- F est une formule. C'est la formule que nous voulons montrer. Nous dirons que cette formule est la "conclusion du séquent".
R1. Si ![]() nous pourrons noter
nous pourrons noter ![]() au lieu de
au lieu de ![]() . Le signe
. Le signe ![]() se lit "thèse" ou "démontre".
se lit "thèse" ou "démontre".
R2. Nous noterons ![]() un séquent dont l'ensemble d'hypothèses est vide et
un séquent dont l'ensemble d'hypothèses est vide et ![]() un séquent dont l'ensemble d'hypothèses est
un séquent dont l'ensemble d'hypothèses est ![]() .
.
R3. Nous noterons que dans le séquent ![]() la formule A peut-être dans
la formule A peut-être dans ![]() (elle devient alors un hypothèse).
(elle devient alors un hypothèse).
R4. Nous écrirons ![]() pour dire que "
pour dire que "![]() est non prouvable".
est non prouvable".
D2. Un séquent ![]() est "prouvable" (ou démontrable, dérivable) s'il peut être obtenu par une application finie de règles. Une formule F est prouvable si le séquent
est "prouvable" (ou démontrable, dérivable) s'il peut être obtenu par une application finie de règles. Une formule F est prouvable si le séquent ![]() est prouvable.
est prouvable.
RÈGLES DE DÉMONSTRATION
Les règles de démonstration sont les briques qui permettent de construire les dérivations. Une dérivation formelle est un assemblage fini (et correct!) de règles. Cet assemblage n'est pas linéaire (ce n'est pas une suite) mais un "arbre". Nous sommes en effet souvent amenés à faire des branchements.
Nous allons présenter un choix de règles. Nous aurions pu en présenter d'autres (à la place ou en plus) qui donneraient la même notion de prouvabilité. Celles que l'on a choisies sont "naturelles" et correspondent aux raisonnements que l'on fait habituellement en mathématique. Dans la pratique courante nous utilisons, en plus des règles ci-dessous, beaucoup d'autres règles mais celles-ci peuvent se déduire des précédentes. Nous les appellerons "règles dérivées".
Il est de tradition d'écrire la racine de l'arbre (le séquent conclusion) en bas, les feuilles en haut: la nature est ainsi faite... Comme il est également de tradition d'écrire, sur une feuille de papier, de haut en bas, il ne serait pas déraisonnable d'écrire la racine en haut et les feuilles en bas. Il faut faire un choix !
Une règle se compose:
- d'un ensemble de "prémisses": chacune d'elles est un séquent. Il peut y en avoir zéro, un ou plusieurs
- du séquent conclusion de la règle
- d'une barre horizontale séparant les prémisses (en haut) de la conclusion (en bas). Sur la droit de la barre, nous indiquerons le nom de la règle.
![]() Exemple:
Exemple:
![]() (1.30)
(1.30)
Cette règle à deux prémisses (![]() et
et ![]() ) et une conclusion (
) et une conclusion (![]() ). Le nom abrégé de cette règle est
). Le nom abrégé de cette règle est ![]() .
.
Cette règle peut se lire de deux manières :
- de bas en haut: si nous voulons prouver la conclusion, il suffit par utilisation de la règle de prouver les prémisses. C'est ce qu'on fait quand nous cherchons une démonstration. Cela correspond à "l'analyse".
- de haut en bas: si nous avons prouvé les prémisses, alors nous avons aussi prouvé la conclusion. C'est ce que nous faisons fait quand nous rédigons une démonstration. Cela correspond à la "synthèse".
Pour les démonstrations il existe un nombre fini de règles au nombre de 17 que nous allons définir ci-après:
1. Axiome:
![]() (1.31)
(1.31)
De bas en haut : si la conclusion du séquent est une des hypothèses, alors le séquent est prouvable.
2. Affaiblissement:
![]() (1.32)
(1.32)
Explications :
- De haut en bas : si nous démontrons A sous les hypothèses ![]() , en ajoutant d'autres hypothèses on peut encore démontrer A.
, en ajoutant d'autres hypothèses on peut encore démontrer A.
- De bas en haut : il y a des hypothèses qui peuvent ne pas servir
3. Introduction de l'implication:
![]() (1.33)
(1.33)
- De bas en haut: pour montre que ![]() nous supposons A (c'est-à-dire que nous l'ajoutons aux hypothèses) et nous démontrons B.
nous supposons A (c'est-à-dire que nous l'ajoutons aux hypothèses) et nous démontrons B.
4. Elimination de l'implication:
![]() (1.34)
(1.34)
- De bas en haut : pour démontrer B, si nous connaissons un théorème de la forme ![]() et si nous pouvons démontrer le lemme
et si nous pouvons démontrer le lemme ![]() , il suffit de démontrer A.
, il suffit de démontrer A.
5. Introduction à la conjonction:
![]() (1.35)
(1.35)
- De bas en haut : pour montrer ![]() , il suffit de montrer A et de montrer B.
, il suffit de montrer A et de montrer B.
6. Elimination de la conjonction:
![]() (1.36) et
(1.36) et ![]() (1.37)
(1.37)
- De haut en bas: de ![]() , nous pouvons déduire A (élimination gauche) et B (élimination droite).
, nous pouvons déduire A (élimination gauche) et B (élimination droite).
7. Introduction de la disjonction:
![]() (1.38) ou
(1.38) ou ![]() (1.39)
(1.39)
- De bas en haut: pour démontrer ![]() , il suffit de démontrer A (disjonction gauche) ou de démontrer B (disjonction droite).
, il suffit de démontrer A (disjonction gauche) ou de démontrer B (disjonction droite).
8. Elimination de la disjonction:
![]() (1.40)
(1.40)
- De bas en haut : si nous voulons montrer C et que nous savons que nous avons ![]() , il suffit de le montrer d'une part en supposant A, d'autre part en supposant B. C'est un raisonnement par cas.
, il suffit de le montrer d'une part en supposant A, d'autre part en supposant B. C'est un raisonnement par cas.
9. Introduction de la négation:
![]() (1.41)
(1.41)
- De bas en haut: pour montrer ![]() , nous supposons A et nous démontrons l'absurde (
, nous supposons A et nous démontrons l'absurde (![]() ).
).
10. Elimination de la négation:
![]() (1.42)
(1.42)
- De haut en bas : si nous avons montré ![]() et A, alors nous avons montré l'absurde (
et A, alors nous avons montré l'absurde (![]() )
)
11. Absurdité classique:
![]() (1.43)
(1.43)
- De bas en haut: pour démontrer A, il suffit de démontrer l'absurde en supposant ![]() .
.
Cette règle, est équivalente à dire : A est vraie si et seulement si il est faux que A soit fausse. Cette règle ne va pas de soi : elle est nécessaire pour prouver certains résultats (il y a des résultats que nous ne pouvons pas prouver si nous n'avons pas cette règle). Contrairement, à beaucoup d'autres, cette règle peut par ailleurs être appliquée à tout moment. Nous pouvons, en effet, toujours dire : pour prouver A je suppose ![]() et je vais chercher une contradiction.
et je vais chercher une contradiction.
12. Introduction au quantificateur universel:
![]() (1.44)
(1.44)
- De bas en haut: pour démontrer ![]() , il suffit de montrer A en ne faisant aucune hypothèse sur x.
, il suffit de montrer A en ne faisant aucune hypothèse sur x.
13. Elimination du quantificateur universel:
![]() (1.45)
(1.45)
- De haut en bas: de ![]() , nous pouvons déduire
, nous pouvons déduire ![]() pour n'import quel terme t. Ce que nous pouvons dire aussi sous la forme: si nous avons prouvé A pour tout x, alors nous pouvons utiliser Aavec n'importe quel objet t (!!).
pour n'import quel terme t. Ce que nous pouvons dire aussi sous la forme: si nous avons prouvé A pour tout x, alors nous pouvons utiliser Aavec n'importe quel objet t (!!).
14. Introduction du quantificateur existentiel:
![]() (1.46)
(1.46)
- De bas en haut: pour démontrer ![]() , il suffit de trouver un objet (in extenso un terme t) pour lequel nous savons montrer
, il suffit de trouver un objet (in extenso un terme t) pour lequel nous savons montrer ![]() .
.
15. Elimination du quantificateur existentiel:
![]() (1.47)
(1.47)
- De bas en haut: nous démontrons qu'il existe bien un ensemble d'hypothèses tel que ![]() et partant de ce résultat comme nouvelle hypothèse, nous démontrons C. Cette formule C hérite alors de la formule
et partant de ce résultat comme nouvelle hypothèse, nous démontrons C. Cette formule C hérite alors de la formule ![]() et dès lors x n'est pas libre dans C car il ne l'était déjà pas dans
et dès lors x n'est pas libre dans C car il ne l'était déjà pas dans ![]() .
.
16. Introduction de l'égalité:
![]() (1.48)
(1.48)
De bas en haut: nous pouvons toujours montrer t=t. Cette règle signifie que l'égalité est réflexive (cf. chapitre Opérateurs).
17. Elimination de l'égalité:
![]() (1.49)
(1.49)
- De haut en bas: si nous avons démontré ![]() et t=u, alors nous avons démontré
et t=u, alors nous avons démontré ![]() . Cette règle exprime que les objets égaux ont les mêmes propriétés. Nous noterons cependant que les formules (ou relations) t=u et u=t ne sont pas, formellement, identiques. Il nous faudra démontrer que l'égalité est symétrique (nous en profiterons aussi pour démontrer que l'égalité est transitive).
. Cette règle exprime que les objets égaux ont les mêmes propriétés. Nous noterons cependant que les formules (ou relations) t=u et u=t ne sont pas, formellement, identiques. Il nous faudra démontrer que l'égalité est symétrique (nous en profiterons aussi pour démontrer que l'égalité est transitive).
![]() Exemples:
Exemples:
E1. Cet exemple montre que l'égalité est symétrique (un petit peu non trivial mais bon pour commencer) :
 (1.50)
(1.50)
- De haut en bas: nous introduisons l'égalité ![]() et prouvons à partir de l'hypothèse
et prouvons à partir de l'hypothèse ![]() la formule
la formule![]() . En même temps, nous définissons l'axiome comme quoi
. En même temps, nous définissons l'axiome comme quoi ![]() . Ensuite à partir de ces prémisses, nous éliminons l'égalité
. Ensuite à partir de ces prémisses, nous éliminons l'égalité ![]() en substituant les termes de façon à ce que à partir de la supposition
en substituant les termes de façon à ce que à partir de la supposition ![]() (venant de l'axiome) nous obtenions
(venant de l'axiome) nous obtenions ![]() . Ensuite, l'élimination de l'égalité implique automatiquement sans aucune hypothèse que
. Ensuite, l'élimination de l'égalité implique automatiquement sans aucune hypothèse que ![]() . Dès lors, il nous suffit d'introduire le quantificateur universel pour chacune des variables (donc deux fois) sans aucune hypothèse afin d'obtenir que l'égalité est symétrique.
. Dès lors, il nous suffit d'introduire le quantificateur universel pour chacune des variables (donc deux fois) sans aucune hypothèse afin d'obtenir que l'égalité est symétrique.
E2. Cet exemple montre que l'égalité est transitive (c'est-à-dire si ![]() et
et ![]() alors
alors ![]() ) . En notant F la formule
) . En notant F la formule ![]() :
:
 (1.51)
(1.51)
Que faisons, nous ici ? Nous introduisons d'abord la formule F deux fois en tant qu'axiome afin de la décortiquer plus tard à gauche et à droite (nous n'introduisons pas l'égalité supposée déjà introduite en tant que règle). Une fois ceci fait, nous éliminons à gauche et à droite la conjonction sur la formule pour travailler sur les termes gauches et droites seuls et introduisons l'égalité sur les deux termes ce qui fait qu'à partir de la formule nous avons l'égalité transitive. Il s'ensuit que sans aucune hypothèse cela implique automatiquement que l'égalité est transitive et finalement nous disons que ceci est valable pour tout valeur des différentes variables (si la formule est vraie, alors l'égalité est transitive).
E3. L'objectif sera de démontrer que toute involution est une bijection (cf. chapitre de Théorie Des Ensembles). Soit f un symbole de fonction unaire (à une variable), nous notons (pour plus de détails voir le chapitre de Théorie Des Ensembles) :
- ![]() la formule:
la formule:
![]() (1.52)
(1.52)
qui signifie que f est injective.
- ![]() la formule:
la formule:
![]() (1.53)
(1.53)
qui signifie que f est surjective
- ![]() la formule:
la formule:
![]() (1.54)
(1.54)
qui signifie que f est bijective.
- ![]() la formule:
la formule:
![]() (1.55)
(1.55)
qui signifie que f est une involution (nous notons également cela ![]() c'est-à-dire que la composition de f est l'identité).
c'est-à-dire que la composition de f est l'identité).
Nous aimerions savoir si :
![]() (1.56)
(1.56)
Nous allons présenter (en essayant que ce soit au plus clair) cette démonstration de quatre manières différentes : classique (informelle), classique (pseudo-formelle) et formelle en arbre et formelle en ligne.
Méthode classique :
Nous devons montrer que si f est involutive alors elle est donc bijective. Nous avons donc deux choses à montrer (et les deux doivent être satisfaites en même temps) : que la fonction est injective et surjective.
1. Montrons que l'involution est injective. Nous supposons pour cela, puisque f est involutive elle est donc injective, tel que :
![]() (1.57)
(1.57)
implique:
![]() (1.58)
(1.58)
Or, cette supposition découle automatiquement de la définition de l'involution que:
![]() (1.59)
(1.59)
et de l'application de f à la relation :
![]() (1.60)
(1.60)
(soit trois égalités) tel que:
![]() (1.61)
(1.61)
nous avons donc:
![]() (1.62)
(1.62)
2. Montrons que l'involution est surjective : si elle est surjective, alors nous devons avoir:
![]() (1.63)
(1.63)
Or, définissons la variable x par définition de l'involution elle-même:
![]() (1.64)
(1.64)
(puisque ![]() ...) un changement de variables après nous obtenons:
...) un changement de variables après nous obtenons:
![]() (1.65)
(1.65)
et donc la surjectivité est assurée.
Méthode pseudo-formelle :
Nous reprenons la même chose et nous y injectons les règles de la théorie de la démonstration :
Nous devons montrer que f involutive est donc bijective. Nous avons donc deux choses à montrer ![]() (et les deux doivent être satisfaites en même temps) : que la fonction est injective et surjective:
(et les deux doivent être satisfaites en même temps) : que la fonction est injective et surjective:
![]() (1.66)
(1.66)
1. Montrons d'abord que l'involution est injective. Nous supposons pour cela, puisque f est involutive et donc injective, que:
![]()
![]() (1.67)
(1.67)
implique:
![]()
![]() (1.68)
(1.68)
Or, cette supposition découle automatiquement de la définition de l'involution que:
![]()
![]() (1.69)
(1.69)
et de l'application de f à la relation:
![]() (1.70)
(1.70)
(soit trois égalités ![]() ) tel que:
) tel que:
![]() (1.71)
(1.71)
nous avons donc:
![]() (1.72)
(1.72)
2. Montrons que l'involution est surjective. Si elle est surjective, alors nous devons avoir:
![]()
![]() (1.73)
(1.73)
Or, définissons la variable x par définition de l'involution elle-même:
![]()
![]() (1.74)
(1.74)
(puisque ![]() ...) un changement de variables après nous obtenons:
...) un changement de variables après nous obtenons:
![]() (1.75)
(1.75)
et donc:
![]() (1.76)
(1.76)
la surjectivité est assurée.
Méthode formelle en arbre :
Faisons cela avec la méthode graphique que nous avons déjà présentée plus haut.
1. Montrons que l'involution est injective :
Pour cela, d'abord montrons que ![]()
 (1.77)
(1.77)
Dès lors :
 (1.78)
(1.78)
2. Montrons que l'involution est surjective :
 (1.79)
(1.79)
Il s'ensuit :
![]() (1.80)
(1.80)
Méthode formelle en ligne :
Nous pouvons faire la même chose sous une forme un peu moins... large... et plus tabulée... (cela n'en est pas moins indigeste) :
| Nom | Description | Exemple | |
| 1 |
Enoncé mal formé |
Non-sens. Ni vrai, ni faux |
|
| 2 |
Tautologie |
Enoncé toujours vrai |
|
| 3 |
Contradiction |
Enoncé toujours faux |
|
| 4 |
Enoncé contingent |
Enoncé parfois vrai, parfois faux |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21:54 Publié dans Théorie de la démonstration | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
La Géométrie du triangle , exercices résolus Yvonne Sortais, René Sortais Livre
09:20 | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Topologie, calcul différentiel et variable complexe Jean Saint-Raymond Etude (broché). Paru en 10/2008 Livre
09:03 | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Invitation à l'algèbre , Théorie des groupes, des anneaux, des corps et des modules Alain Jeanneret, Daniel Lines Etude (broché). Paru en 05/2008 Livre
09:02 | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Chimie et théorie des groupes Paul H. Walton, Jean-Pierre Gaspard, François-Xavier Sauvage Scolaire / Universitaire (broché). Paru en 06/2001
09:01 | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Théorie des groupes , Rappel de cours, exercices, problèmes résolus J. Delcourt Etude (broché). Paru en 03/2007
09:00 | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Algèbre groupes anneaux corps , Cours et exercices corrigés Jean-Jacques Risler, P. Boyer Scolaire / Universitaire (broché). Paru en 02/2006 Livre
07:38 | Lien permanent | Commentaires (1) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Classical topology and combinatorial group theory John Stillwell relié. Paru en 08/1995 Livre
07:37 | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Topologie en grande section Collectif Etude (broché). Paru en 07/2001 Livre
07:34 | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook







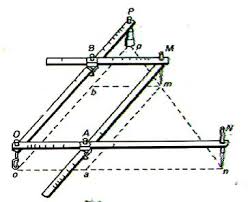



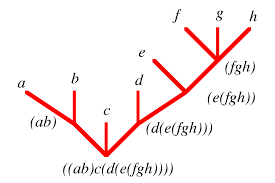

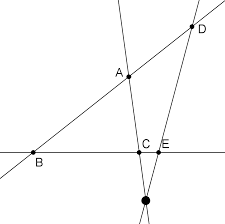

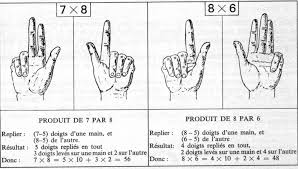
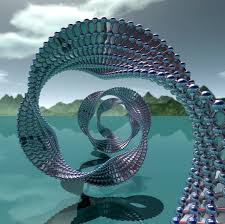


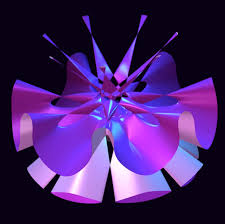






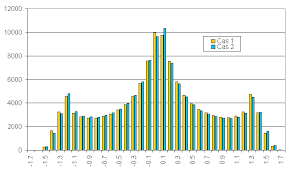
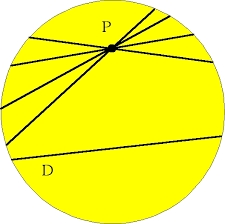

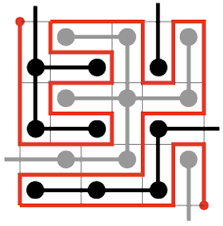
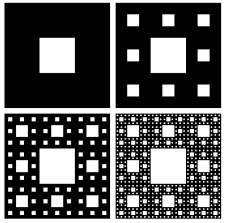
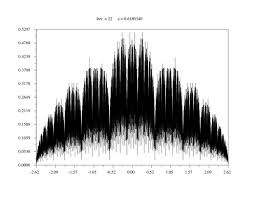
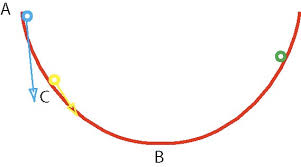

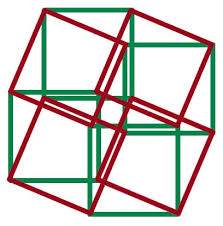






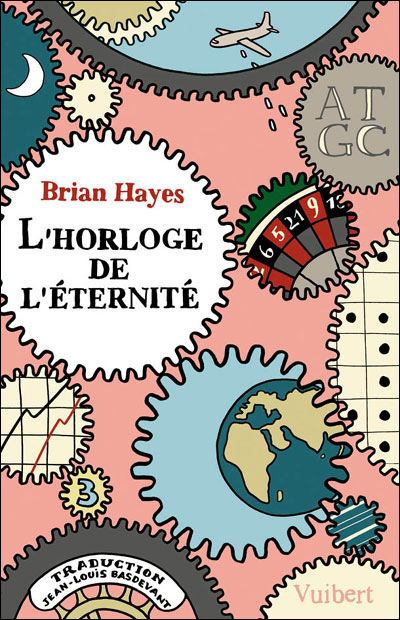
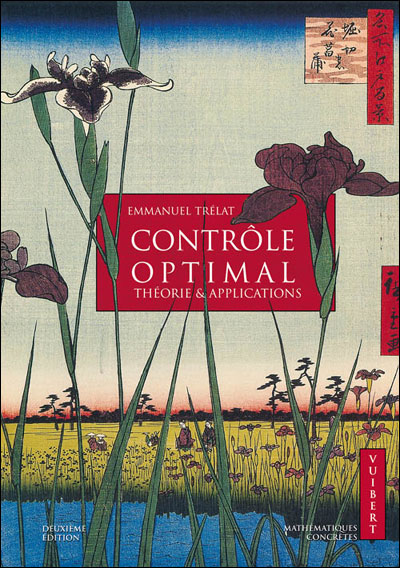


 est le
est le